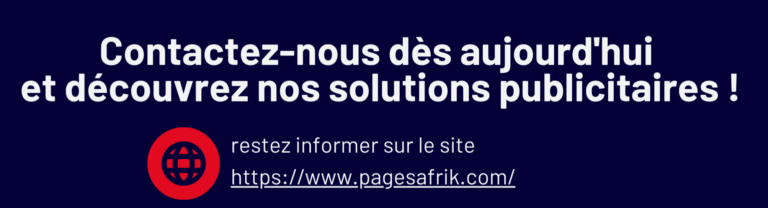Le Cameroun n’échappera pas au feu qui couve si le régime du président Paul Biya n’accepte pas une transition pacifique

Ce magnifique pays, déjà déchiré par la guerre, n’a pas besoin de sombrer dans le chaos. Le président Biya a perdu les élections. Nous l’avons dit ici dès les premières heures des dépouillements, après des nuits entières de recoupements et de compilations des vidéos et photos des bureaux de vote. Cette tendance a été confirmée par l’équipe d’Issa Tchiroma Bakary qui, depuis quelques jours, publie des chiffres avoisinant ces premières projections. Plus de 54 % en faveur du candidat de l’opposition n’est pas le résultat final. C’est un résultat issu du dépouillement d’environ 90 % du territoire. Le score sera encore plus conséquent si l’on prend en compte les 10 % restants. Malheureusement, cette vérité vraie, absolue, inattaquable et inviolable est sur le point d’être torpillée par un régime de 43 ans qui ne s’est maintenu jusqu’ici que par la ruse et la force. Malheureusement pour lui, 2025 est complètement différent de 2018. 1. D’abord parce qu’il y a une population déterminée, prête à en découdre. Dans le Nord et l’Extrême-Nord, ce qui se passe n’est rien comparé à ce qui se prépare. Le peuple camerounais s’organise jusque dans le Grand Sud. Les leaders de la société civile se concertent et attendent le moment venu pour, unanimement, donner le mot d’ordre. 2. Parce qu’il y a un Issa Tchiroma vindicatif, frontal, résolu à exercer le pouvoir d’État. Tchiroma n’a ni la patience ni la passivité du professeur Maurice Kamto. J’ai écouté tous ses discours : il n’exclut littéralement aucune option. Il n’a pas fait sienne la formule de « l’alternance dans la paix et par les urnes ». Si nous analysons les « non-dits », on comprend aisément que toutes les options sont sur la table pour contraindre le régime de Yaoundé à reconnaître sa défaite, plier bagage et se retirer de la gouvernance d’un pays qu’il n’a même pas été capable de gérer. À ceux qui nous disent qu’il ne faut pas encourager l’implosion, j’ai envie de demander : qui incendie ? Une population qui appelle depuis des jours à respecter la vérité des urnes ? Ou un pouvoir avide de sang qui détient l’allumette au-dessus de l’essence ? Par Teddy Patou Journaliste et animateur radio
Cameroun. Issa Tchiroma Bakary : ni ange ni démon, mais un politicien

SANS DETOUR. Tel un renard, le politicien s’engouffre dans la moindre brèche, exploite la faille la plus subtile et s’insère dans la fissure la plus fine : c’est cela, la ruse politique. Rien à voir avec la perfidie ni la barbarie cynique de l’exécutif abject de Yaoundé. L’engouement que vous observez autour du candidat Issa Tchiroma n’est pas un coup de foudre populaire. Ce n’est pas non plus une prestidigitation envoûtante qui aurait charmé le peuple camerounais. C’est l’expression d’un ras-le-bol collectif, d’une rupture radicale avec le régime de Yaoundé. Dans la logique du « Tout sauf Biya », les Camerounais sont prêts à miser, à raison, sur le diable lui-même. Mais pourquoi Issa Tchiroma, et pas un autre ? Pourquoi lui, alors qu’il était, il y a peu, ministre de Paul Biya, partie prenante de la coalition gouvernementale et véritable laudateur d’un exécutif corrompu et incompétent ? La réponse est simple : il est aujourd’hui le seul candidat à tenir un discours tranchant de rupture. Le plus frontal, le plus incisif contre le régime de Paul Biya. Ses sorties médiatiques sont de plus en plus véhémentes. « Je défendrai ma victoire jusqu’à mon sang si les Camerounais m’accordent la faveur des urnes ». . Dans le contexte actuel, cette phrase résonne plus fort qu’un programme politique, et Tchiroma l’a compris. Il a compris qu’un naufragé est capable de s’accrocher à la queue d’un serpent pour tenter de se sauver. Et cette allégorie colle parfaitement à la situation camerounaise, un prêtre l’a même paraphrasée : « Vaut mieux un diable que Paul Biya. » Issa Tchiroma Bakary a également compris qu’après l’élimination brutale du professeur Maurice Kamto, le peuple du changement était en quête d’un opposant farouche, prêt au sacrifice suprême pour voir tomber le régime en place. Beaucoup considèrent d’ailleurs cette élection comme un prétexte, un casus belli, qui pourrait enclencher un mouvement de contestation populaire à la népalaise. Tchiroma a ajusté son langage, affûté son discours et adapté ses positions pour répondre à cette aspiration. Faut-il lui faire confiance ? Non. Pas plus qu’on ne doit faire confiance à la queue du serpent. Mais dans une telle situation, il représente le meilleur risque, la dernière chance ( même si elle n’est qu’apparente) . Comme le parieur de la dernière heure, il faut fermer les yeux et miser sa dernière pièce. Soit l’on gagne, soit l’on perd tout, même le dernier franc de la veuve. Mais au moins, on aura essayé. Et ne dit-on pas : qui ne risque rien n’a rien ? Moi, je voterai pour Issa Tchiroma Bakary. Par Teddy Patou Journaliste et animateur radio
CAMEROUN : la photocratie

HAUT-ET-FORT. La photocratie, ou gouvernance par la photo, est un néologisme crée par les Camerounais pour décrire l’invisibilité de leur président. Complètement effacé de la vie publique, Paul Biya (bientôt centenaire) se montre rarement. Chaque apparition devient un événement célébré par ses partisans. Depuis janvier, il n’a été vu que trois fois. Enfin… deux fois et demi pour être précis. Lors de la fête de l’unité, il fut brièvement aperçu, filmé de loin, comme pour cacher une sénilité pourtant évidente. Paul Biya a toujours été distant du peuple camerounais, non pas seulement à cause de son âge, mais sans doute par manque d’amour. En quarante-trois ans, il n’a jamais visité toutes les dix régions du pays. Peut-être refuse-t-il d’exposer ses yeux et sa conscience à la misère hideuse qu’il a contribué à créer ? En revanche, mon président adore la Suisse. Jusqu’à récemment, il passait les trois quarts de l’année à l’hôtel Intercontinental de Genève, dont il a finalement été chassé par des activistes camerounais. Il aime aussi la France, où il se vante d’être le “meilleur élève”. Là-bas, il rend compte, pendant que son peuple attend en vain des comptes. Le mépris de Paul Biya est tel qu’il fait recevoir les chefs traditionnels par de simples supplétifs du palais. Mais il trouve encore la force de rencontrer l’ambassadeur de France en fin de mission au Cameroun. Une rencontre mise en scène, filmée à bonne distance, pour éviter de zoomer sur un visage marqué par les outrages du temps. Mon président semble dégoûté de ses citoyens. On dirait que nous le répugnons. Même dans les moments de deuil national, il reste absent. En 2020, lors du massacre de Ngarbuh, où une trentaine de civils dont des femmes enceintes et des enfants furent exécutés, le Cameroun attendait son président aux côtés des familles. Il s’est contenté d’un communiqué tardif et de quelques billets de banque. Il fit de même lors de la catastrophe de Dschang, qui fit vingt morts. Son mépris n’épargne personne, pas même la presse. En plus de quatre décennies, on peut compter sur les doigts d’une main le nombre d’interviews accordées aux médias locaux. Inutile de comparer avec les médias français. La distance entre Paul Biya et le peuple qu’il gouverne est abyssale, presque divine, disent certains de ses partisans. Pour eux, il est Dieu, et ils sont ses créatures. Jacques Fame Ndongo, ministre de l’Enseignement supérieur, l’a même affirmé en mondovision. Plus absurde encore : une thèse de doctorat sur le silence de Paul Biya a été validée dans une université camerounaise. Pas étonnant que nos institutions académiques soient reléguées en bas du classement mondial. En vérité, l’échec de Paul Biya n’est pas seulement celui de l’incompétence et de la cupidité. C’est surtout celui d’un homme qui n’a jamais aimé le peuple camerounais. Teddy Patou Journaliste et animateur radio
Cameroun : le théâtre des bouffons politiques

HAUT-ET-FORT. Le syndrome de Stockholm. Pour l’expliquer, inutile d’ouvrir un manuel de psychologie. Racontez seulement l’histoire de Célestin Djamen : tout y est. En 2018, il brandissait fièrement son titre de responsable des droits de l’homme au MRC, principal parti d’opposition. Aux lendemains d’une élection volée, son parti criait au hold-up électoral. Les Camerounais descendaient dans la rue, pacifiquement, pour réclamer la vérité des urnes. Le régime, fidèle à sa tradition répressive, sortit les armes. Premier rassemblement, première balle. Djamen s’écroule, le pied transpercé, traîné devant un tribunal militaire, jeté en prison. Un martyr, croyait-on. Mais à sa sortie, tout s’effondre. Le MRC boycotte les législatives de 2020 : adieu les rêves de strapontins. Djamen se voyait député, maire, notable. Le réveil fut brutal. La frustration se transforma en rancune, la rancune en trahison. Il claque la porte, fonde son propre parti, réduit à une cellule familiale : lui et son cousin. Puis, miracle ! L’ancien pourfendeur du régime découvre soudainement les charmes de Paul Biya. Son discours change : du fouet au baiser, du poing levé à la génuflexion. Hier, il accusait. Aujourd’hui, il rampe. Hier, il criait « hold-up électoral ! ». Aujourd’hui, il jure fidélité au bourreau qui a failli l’amputer. Et voilà Djamen, fraîchement enrôlé dans le fameux G20, ce club de micro-partis ventriloques, conglomérat d’aplaventristes, satellites de la mangeoire. Le plus grotesque ? Dans une interview, il ose déclarer que Paul Biya, 93 ans, fantôme épuisé par l’âge, serait le candidat idéal pour conduire le Cameroun. Le ridicule en costume trois-pièces. Mais Djamen n’est pas seul dans ce cirque. Dans toutes les dictatures, la récompense n’est pas le mérite, mais la servilité. Jean de Dieu Momo en est l’illustration : ex-opposant enflammé, devenu griot officiel. Et que dire du ministre de l’Enseignement supérieur, qui s’est présenté comme « la créature de Paul Biya » ? Une bassesse innommable pour un homme qui prétend encore penser. Ces hommes ravaleront leurs vomissures pour un strapontin. Ils sacrifieront leur honneur sur l’autel d’une nomination. Leur dignité vaut moins qu’une chaise bancale dans un gouvernement fantôme. Voilà le drame du Cameroun : une élite qui trahit pour manger, une classe politique qui vend ses convictions au rabais. Or la politique devrait être le domaine des valeurs, pas celui du ventre. Nous devons réapprendre, coûte que coûte, que la dignité et l’honneur surpassent mille fois tous les biens matériels. Sans cela, nous resterons un peuple enchaîné aux caprices d’un vieillard et aux trahisons de ses bouffons. Par Teddy Patou Journaliste et animateur radio
Cameroun. La grande question : pourquoi vont-ils à l’élection présidentielle s’ils sont sûrs de perdre ?

Ma réponse : ils ne pensent qu’à eux. PARLONS-EN. Le 12 octobre prochain, 11 candidats affronteront Paul Biya lors d’un scrutin biaisé d’avance. Aucun n’a la capacité de le battre. D’abord, parce qu’aucun candidat ne peut contrer la fraude, ni même la contester. Le Conseil constitutionnel, aplatventriste, reptilisé, nommé par Paul Biya, a déjà montré qu’il ne donnera jamais un autre résultat que celui voulu par le palais d’Etoudi. Ensuite, parce que ces opposants (dont certains sont en réalité des proposants) ont prouvé leur laxisme et leur inertie face à une cause aussi noble que le droit à la justice. Beaucoup sont restés silencieux après l’élimination abjecte du principal opposant, Maurice Kamto. D’autres se sont contentés de communiqués verbeux,creux, et les plus répugnants ont même jubilé devant cette injustice. Il y a aussi une raison stratégique : avec la principale force politique écartée, aucun des candidats restants n’a un parti implanté sur l’ensemble du territoire. La plupart restent enfermés dans des enclos tribaux, incapables de dépasser leur région. Alors, pourquoi vont-ils quand même aux élections ? 1. Pour servir d’alibi à une élection qui a commencé sur une fausse note et dont le résultat est connu. 2. Pour espérer, par miracle, un poste dans le futur gouvernement. 3. Pour positionner leur parti en vue de futures législatives. 4. Pour toucher quelques billets pour avoir accompagné la mascarade. Ce qui en ressort, c’est une opposition composée d’égoïstes incapables de voir plus loin que le bout de leur nez, des nombrilistes égocentriques. Une course de cupides et de revanchards, aux ambitions minimalistes, qui refusent de marquer l’Histoire. Que devraient-ils faire ? Ils devraient stopper ce processus électoral, pour punir l’humiliation infligée à toute la République par la clique de Yaoundé. Comprendre que la falsification des documents par le ministère de l’Administration territoriale, l’autopiratage de son site internet, et les décisions absurdes du Conseil constitutionnel constituent une atteinte grave à l’image de notre nation. Aucun Camerounais digne de ce nom ne peut cautionner cela. Par patriotisme, ils devraient suspendre leur participation, appeler le peuple à réparer cette injustice et reprendre le processus sur des bases saines. Mais ils ne le feront pas. Parce qu’ils sont complices. Par Teddy Patou Journaliste et animateur radio
Classement : les 7 présidents africains aux plus longs règnes en 2025

Teodoro Obiang Nguema en Guinée Équatoriale, Paul Biya au Cameroun ou encore Paul Kagame au Rwanda, ils sont près d’une dizaine de présidents à s’être maintenus au pouvoir durant des décennies. Entre modifications de la constitution, mainmise sur les élections et autres mesures autocratiques, ils ont tout osé et tout reformé pour demeurer chef d’États. Paul Kagamé, Rwanda (25 ans) Réélu le 15 juillet 2024, Paul Kagamé est président de la République du Rwanda depuis le 24 mars 2000, soit 25 ans. Âge de 67 ans, il était commandant du Front patriotique rwandais (FPR), un mouvement rebelle qui combattait le pouvoir Hutu. Il remporte la guerre civile rwandaise et met fin au génocide des Tutsi en 1994. Par la suite, il devient vice-président et ministre de la Défense, sous la présidence de Pasteur Bizimungu. À son poste, il soutient une invasion rebelle du Zaïre en 1996, menant au renversement du président zaïrois Mobutu Sese Seko en 1997. Il soutient également plusieurs groupes rebelles dans la deuxième guerre du Congo, de 1998 à 2003, contre le nouveau gouvernement congolais de Laurent-Désiré Kabila puis de son fils Joseph Kabila. Après la démission de Pasteur Bizimungu en 2000, il accède à la présidence en tant que quatrième président du Rwanda et depuis, il sera systématiquement réélu. Alors que beaucoup apprécient son bilan économique, il est considéré par plusieurs observateurs comme étant un dictateur. Il est accusé par l’ONU d’être partie prenante à la guerre du Kivu dans l’est de la République démocratique du Congo, en soutenant le Mouvement du 23 mars (M23), groupe armé rebelle accusé de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité. Ismail Omar Guelleh, Djibouti (26 ans) On n’entend pas souvent parler de lui, mais Ismail Omar Guelleh, 77 ans, Président de la République de Djibouti, a une longévité à ne pas négliger. Guelleh dirige le pays depuis 26 ans, détenant le record de longévité à la présidence de Djibouti. Il arrive au pouvoir le 08 mai 1999, succédant à son oncle Hassan Gouled Aptidon, et devient le deuxième président de Djibouti en mai 1999. En 1965, âgé de 18 ans, Ismail Omar Guelleh commence à travailler au sein des Renseignements généraux du Territoire français des Afars et des Issas, car il est polyglotte, s’exprimant en amharique, somalien, arabe, français, italien et anglais. En 1974, il est suspendu de ses fonctions, car soupçonné de transmettre des informations à la mouvance indépendantiste. Il s’investit alors dans la Ligue populaire africaine pour l’indépendance (LPAI) présidée par Hassan Gouled Aptidon, qui milite pour l’indépendance. Membre du parti présidentiel, le Rassemblement populaire pour le progrès (RPP), dès sa création en 1979, il est élu président du comité central et de la commission culturelle en 1981. La liberté de presse est presque inexistante sous son gouvernement. En 2025, Reporters sans frontières situe Djibouti à la 168e place sur 180 pays, décrivant une situation de « terreur médiatique » où tout un arsenal répressif est déployé contre les journalistes. Le 9 avril 2021, Ismaïl Omar Guelleh est réélu pour un 5e mandat à la tête de l’État dès le premier tour avec 98,58 % des voix. Isaias Afwerki, Érythrée (32 ans) Isaias Afwerki est président de l’Érythrée depuis son indépendance, en 1993. Avant cette date, le pays était lié à l’Éthiopie, lui garantissant son ultime façade maritime. Le président érythréen a été l’un des principaux artisans de cette indépendance, obtenue grâce à un référendum soutenu par l’ONU le 24 mai 1993. En février 1994, le FPLE est renommé Front populaire pour la démocratie et la justice (FPDJ) lors de son troisième congrès et Afwerki reste le secrétaire général du parti unique du nouvel État. Dès le début de son mandat, Isaias Afwerki instaure un régime de parti unique, sans élections, une économie centralisée sur l’État et une forte restriction de la liberté de la presse. Après la deuxième guerre contre l’Éthiopie (de 1998 à 2000), le président Afwerki fait basculer son pays dans la dictature. Son pays est considéré comme l’un des plus fermé au monde. Yoweri Museveni, Ouganda (39 ans) Yoweri Museveni est à la tête du gouvernement ougandais depuis 1986, soit 39 ans. Commandant du Mouvement de résistance nationale (NRM), il fait partie des rebelles qui ont renversé les dirigeants ougandais Idi Amin (1971-1979) et Milton Obote (1980-1985). Reconnu comme héros par l’Occident, Museveni va supprimer la limitation de mandats présidentiels en 2005, lui permettant ainsi de se maintenir au pouvoir. En 2018, il supprime la limite d’âge présidentielle puis gagne un sixième mandat à l’issue de l’élection présidentielle de 2021. Il va aussi se distinguer en 2014 par ses lois anti-homosexualité visant à introduire la peine de mort pour les personnes LGBT+. En politique extérieure, il soutient une invasion rebelle du Zaïre pendant la première guerre du Congo en 1996, menant au renversement du dictateur zaïrois Mobutu Sese Seko l’année suivante. Il soutient également plusieurs groupes rebelles, notamment le Mouvement de libération du Congo (MLC) contre le nouveau gouvernement congolais de Laurent-Désiré Kabila puis de son fils Joseph Kabila dans la deuxième guerre du Congo de 1998 à 2003. Au cours de sa présidence, Yoweri Museveni fait face à l’insurrection de l’Armée de résistance du Seigneur mais ne faiblit pas. Denis Sassou-Nguesso, République du Congo (41 ans) À 82 ans, Denis Sassou-Nguesso est le président de la République du Congo depuis 41 ans. Initialement militaire et homme d’État congolais, il est devenu chef de l’État pour la première fois en mars 1979 et a dirigé le pays jusqu’en août 1992. Il est revenu au pouvoir après une guerre civile en 1997 et est resté en poste depuis, écrasant toute opposition politique significative. Pour retrouver le pouvoir, il a renversé le président élu : Pascal Lissouba, lors de la guerre civile du Congo-Brazzaville. Dès les années 1960, Denis Sassou-Nguesso participe à la mouvance des officiers progressistes qui lui donne une place parmi les trente-neuf membres du Conseil national de la révolution. Il finit par les diriger. Il fonde ensuite le Parti congolais
Élections présidentielles au Cameroun : pourquoi une révolution populaire avant le scrutin est irréaliste

1. Un contexte défavorable L’idée d’une révolution populaire pour renverser le gouvernement Biya avant l’élection est presque irréalisable dans le contexte actuel. Les divisions ethniques, politiques et sociales sont trop profondes pour permettre une mobilisation unifiée. Ce type d’initiative a déjà été tenté après l’élection de 2018, sans succès. Une révolution populaire repose sur une prise de conscience collective et une cause partagée par une majorité. Or, au Cameroun, cette unité n’existe pas encore. Certains défendent leurs intérêts ethniques, même s’ils sont eux-mêmes victimes du système. D’autres refusent de s’engager pour des raisons individuelles. Trop de fractures empêchent une action concertée. 2. Le risque d’une guerre interethnique Le Cameroun est déjà fragilisé par des tensions ethniques. Ces tensions ne sont pas seulement verbales : elles se traduisent par des actes concrets. • Certains Camerounais ont été interdits d’entrer dans certaines régions à cause de leur ethnie. • D’autres ont été expulsés de villes où ils n’étaient pas considérés comme autochtones. Ces événements sont autant de signaux alarmants. Une révolution risquerait d’attiser ces tensions et de provoquer un conflit interethnique généralisé. 3. L’élection, une alternative à défaut de mieux Même si les élections au Cameroun sont souvent biaisées, elles restent, pour l’instant, l’unique alternative pour éviter un chaos incontrôlable. Elles offrent un cadre, aussi imparfait soit-il, qui peut permettre, à terme, d’éveiller une conscience collective et de poser les bases d’un véritable changement. Teddy Patou Journaliste et animateur radio.
CAMEROUN: Une élection pour trois destins

TRIBUNE. 2025 sera une année électorale cruciale au Cameroun. Depuis l’avènement de la pseudo-démocratie, chaque scrutin a été marqué par des tensions, mais celui-ci s’annonce particulièrement sensible en raison de deux particularités qui renforcent les inquiétudes. Le contexte politique : une opposition renforcée et structurée Depuis les élections de 2018 et la crise post-électorale qui a suivi, l’opposition camerounaise s’est reconstruite et renforcée. Une aile dure s’est dégagée, capable de contester, de mobiliser et d’entonner une musique de la révolte dont le refrain pourrait se généraliser. Surtout, une opposition structurée et prête à diriger a émergé, composée d’hommes et de femmes d’État dont le sérieux ne souffre d’aucune critique. L’engouement populaire : un électorat réveillé Pendant des années, les errements des gouvernants ont éloigné les Camerounais de la politique. Les citoyens, désabusés, répétaient des expressions comme « Que je vote ou pas, il va gagner« , comparant la politique à une musique écoutée en boucle jusqu’à l’écœurement. Cependant, les choses semblent avoir changé. La récente mobilisation pour l’inscription sur les listes électorales en est la preuve : elle a atteint un niveau sans précédent. Trois destins possibles : 1. Un coup d’État militaire (orchestré depuis l’étranger) Un général camerounais a déclaré qu’en 1991, si le président Biya avait perdu le pouvoir, les militaires l’auraient repris par la force. Après 43 ans de pouvoir, les éléments du système se sont enracinés et renforcés, rendant leur délogement difficile. Certains pourraient préférer brûler le pays plutôt que de perdre leurs privilèges et leur bourgeoisie compradore. 2. Une nouvelle victoire du président Paul Biya (92 ans) Bien qu’il n’ait pas encore déclaré sa candidature, Paul Biya, au pouvoir depuis 1982 et dans les arcanes du pouvoir depuis 1962, pourrait se représenter. En cas de victoire, le Cameroun risquerait de connaître une révolte populaire, tant le mécontentement est palpable. 3. Une transition démocratique apaisée (le destin souhaité, mais le moins probable) En cas de victoire du parti au pouvoir ou de l’opposition, des félicitations pourraient être échangées au nom de la paix. Cependant, ce scénario reste peu probable dans un contexte aussi polarisé. Teddy Patou Journaliste et animateur radio.