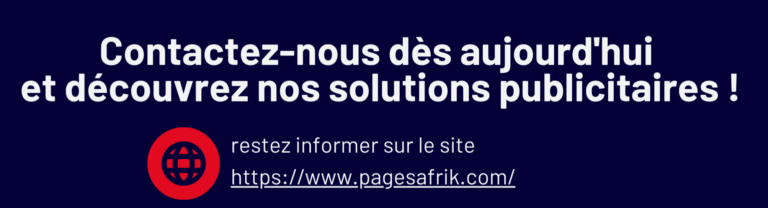Marché du travail au Maroc : Casablanca-Settat et le Sud en tête pour l’emploi et le chômage

MARCHE DU TRAVAIL. Selon les chiffres publiés récemment par le Haut-commissariat au plan (HCP), cinq régions abritent 72,3% de l’ensemble des actifs âgés de 15 ans et plus au Maroc. Dans sa note d’information relative à la situation du marché du travail au deuxième trimestre de 2025, la région de Casablanca-Settat se situe en première position avec 22,2% d’actifs, suivie de Rabat-Salé-Kénitra (13,6%), de Marrakech-Safi (13%), de Fès-Meknès (11,8%) et de Tanger-Tétouan-Al Hoceima (11,7%). Les données recueillies montrent que quatre régions affichent des taux d’activité supérieurs à la moyenne nationale (43,4%): Tanger-Tétouan-Al Hoceima avec 47,9%, le Sud (46,6%), Casablanca-Settat (45,4%) et Marrakech-Safi (43,9%). « En revanche, les taux les plus bas sont enregistrés dans les régions de Béni Mellal-Khénifra (39,7%), de Drâa-Tafilalet (40,1%), de Sous-Massa (40,4%) et de l’Oriental (40,4%), a fait savoir l’institution publique. En ce qui concerne le chômage, il apparait que cinq régions concentrent également 72,3% des chômeurs. Il s’agit de la région de Casablanca-Settat (25,5%), de Fès-Meknès (14,8%), de Rabat-Salé-Kénitra (13,1%), de l’Oriental (10,7%) et de Tanger-Tétouan-Al Hoceima (8,2%). Il est important de noter qu’au deuxième trimestre les taux de chômage les plus élevés sont observés dans les régions du Sud (25,7%) et de l’Oriental (21,1%), comme le souligne la note du Haut-commissariat. Et de préciser qu’ »avec moins d’acuité, deux régions dépassent la moyenne nationale (12,8%) à savoir Fès-Meknès (16,2%) et Casablanca-Settat (14,7%) ». En revanche, tout indique que les régions de Drâa-Tafilalet, de Marrakech-Safi et de Tanger-Tétouan-Al Hoceima enregistrent les taux les plus bas durant cette même période, respectivement 6,4%, 7,5% et 8,9%, a conclu le HCP. Martin Kam
Combler les lacunes et forger les aspirations : l’initiative RELANCE pour élargir les possibilités d’éducation et d’emploi pour les jeunes au Tchad et en Mauritanie

La Banque mondiale a approuvé le Projet d’intervention régionale du Sahel pour l’apprentissage et la collaboration dans l’éducation, ou RELANCE selon son acronyme en anglais. Cette initiative phare vise à renforcer les systèmes éducatifs, élargir l’accès à une éducation de qualité et améliorer les perspectives d’emploi pour les jeunes vulnérables au Tchad et en Mauritanie. D’un montant de 137,15 millions de dollars, le projet est financé par des crédits de l’Association internationale de développement (IDA) et des dons du Fonds fiduciaire pour le Sahel et les pays côtiers de l’Afrique de l’Ouest (SAWAC). Il constitue un engagement important en faveur de l’avenir des jeunes dans l’une des régions les plus précaires du monde. Au Sahel central, un tiers des jeunes ne sont ni en études, ni en emploi, ni en formation professionnelle, et 94 % des enfants âgés de 10 ans sont incapables de lire ou comprendre un texte adapté à leur âge. Au Tchad, 57 % des enfants d’âge primaire ne sont pas scolarisés ; en Mauritanie, ce sont 45 % des jeunes en âge de fréquenter le cycle secondaire qui sont en dehors du système scolaire. Dans ces pays, investir dans l’éducation est une démarche de long terme essentielle pour briser le cercle vicieux de la pauvreté et de la violence dont trop d’enfants et de jeunes sont prisonniers. Le projet RELANCE adopte une approche régionale et innovante pour bâtir une société plus résiliente et inclusive, en prenant acte des difficultés communes au Tchad et à la Mauritanie. Les deux pays connaissent en effet des taux élevés de jeunes non scolarisés et de pauvreté des apprentissages, tandis qu’ils sont également confrontés aux effets de la dégradation de l’environnement, de la fragilité et des conflits. Le projet appuiera la création d’un institut régional d’éducation dédié à la recherche, qui formera également des professionnels de l’éducation et fournira des conseils sur l’action à mener. Cet institut jouera un rôle essentiel dans la promotion de la coopération régionale et l’harmonisation des politiques éducatives, et bénéficiera directement à au moins 1 500 professionnels du secteur dans les deux pays. Le projet RELANCE mettra également en place des parcours éducatifs flexibles et résilients grâce à l’introduction d’un modèle d’« école ouverte » conçu pour 850 000 jeunes nomades et réfugiés non scolarisés et dont la moitié sont des filles. Ce modèle innovant offrira d’autres voies d’accès à l’éducation formelle ou à l’emploi par le biais de la formation professionnelle et technique. Il reposera sur un format hybride combinant enseignement en présentiel et ressources d’apprentissage numériques, et garantira la continuité de l’éducation même dans les circonstances les plus difficiles. Le projet s’attachera à concevoir des centres d’apprentissage résilients, avec l’intégration d’infrastructures économes en énergie et résistantes aux catastrophes. « Le modèle de l’ »école ouverte » est tout à fait novateur et il pourrait véritablement révolutionner les possibilités d’éducation et d’emploi pour les jeunes vulnérables, explique Franz Drees-Gross, directeur par intérim de l’intégration régionale pour l’Afrique et le Moyen-Orient à la Banque mondiale. En favorisant la collaboration entre le Tchad et la Mauritanie, le projet RELANCE permettra d’assurer un maximum d’efficacité et d’impact, de créer des économies d’échelle et d’éviter les initiatives redondantes. » Le projet met en outre fortement l’accent sur l’égalité des sexes, avec des interventions ciblées visant à remédier aux disparités persistantes qui pénalisent les femmes dans les domaines de l’éducation et de la vie économique. Des efforts seront déployés pour accroître la scolarisation et la poursuite d’études des filles, à travers notamment des incitations financières pour les élèves méritantes et vulnérables et le développement de programmes et d’environnements scolaires intégrant la dimension du genre. « Ce projet va changer la donne pour le Tchad et la Mauritanie, souligne Waly Wane, chef de service Éducation à la Banque mondiale. En mettant l’accent à la fois sur l’éducation et les compétences professionnelles, nous faisons en sorte que les jeunes, et en particulier les filles et les populations vulnérables, disposent des outils dont ils et elles ont besoin pour réaliser leur potentiel et contribuer utilement à leur communauté. » Banque Mondiale
Maroc. Pour stimuler la croissance économique et l’emploi: Bank Al-Maghrib abaisse son taux directeur

ECONOMIE. Contre toute attente, le Conseil de Bank Al-Maghrib a décidé mardi 19 de réduire son taux directeur, pour la deuxième fois consécutive et la troisième depuis juin 2024, de 25 pb à 2,25% contre 2,50% précédemment. La décision d’abaisser son taux directeur prend de court les investisseurs et diverses analyses qui pronostiquaient son maintien à son précédent niveau au motif que l’évolution de l’inflation justifiait une stabilité et que des incertitudes persistantes entouraient les perspectives économiques à moyen terme. Cependant, lors de sa première réunion trimestrielle au titre de l’année 2025, la Banque centrale en a décidé autrement, justifiant que sa décision tient « compte de l’évolution prévue de l’inflation à des niveaux en ligne avec l’objectif de stabilité des prix et en vue de renforcer son soutien à l’activité économique et à l’emploi ». Comme à son habitude, le Conseil a en outre affirmé qu’«il continuera de suivre de très près l’évolution de la conjoncture et de fonder ses décisions réunion par réunion sur la base des données les plus actualisées ». Lors de cette session, qui a analysé l’évolution de la conjoncture économique, nationale et internationale, et celle récente en matière de politiques publiques au Maroc, ainsi que les projections macroéconomiques de la Banque à moyen terme, le Conseil a relevé la dynamique notable de l’activité dans les secteurs non agricoles, tirée en particulier par l’investissement, principalement dans les infrastructures. Bien qu’en nette amélioration depuis le début de ce mois, la production du secteur agricole continue de pâtir des conditions climatiques défavorables, a noté le Conseil. Après deux années de niveaux élevés, l’inflation a de son côté connu un ralentissement très sensible en 2024, revenant à 0,9% en moyenne. Selon les projections de Bank Al-Maghrib, elle devrait s’accélérer, tout en restant à un niveau modéré oscillant autour de 2% au cours des deux prochaines années. S’agissant de sa composante sous-jacente, le Conseil indique qu’elle est ressortie à 2,2% en 2024 et évoluerait également autour de 2% à moyen terme. Il souligne toutefois que ces perspectives demeurent entourées de fortes incertitudes liées notamment, au plan externe, à la persistance des tensions géoéconomiques et à leurs implications sur l’inflation mondiale, et au plan interne, à l’évolution de l’offre de produits agricoles. Qu’à cela ne tienne, « le Conseil a, par ailleurs, noté que les anticipations d’inflation restent ancrées, les experts du secteur financier s’attendant au premier trimestre 2025 à des taux moyens de 2,2% pour l’horizon de 8 trimestres et de 2,4% pour celui de 12 trimestres ». Sur le volet de la transmission de ses décisions, le Conseil a indiqué que les données collectées au quatrième trimestre 2024 montrent une baisse de 35 points de base (pb) des taux débiteurs assortissant les crédits bancaires au secteur non financier, comparativement au deuxième trimestre de la même année, contre une réduction de 25 pb du taux directeur au cours de la même période. Il est important de noter que Bank Al-Maghrib a mis en place un nouveau programme de soutien au financement bancaire des très petites entreprises (TPE), avec en particulier un refinancement des banques participantes à un taux préférentiel égal au taux directeur minoré de 25 pb. Selon le Conseil, « ce dispositif et l’engagement exprimé par le secteur bancaire devraient améliorer l’accès au financement de cette catégorie d’entreprises et renforcer sa contribution à la création d’emplois dans notre pays ». Alain Bouithy
Le FIGA : acteur clé de la stratégie du Congo pour l’entrepreneuriat et l’emploi

Le Fonds d’Impulsion, de Garantie et d’Accompagnement (FIGA) a été au cœur de l’adresse présidentielle du 28 novembre, à l’occasion de la célébration de la fête de la République. Dans son discours, le Président de la République a salué le rôle central du FIGA dans le soutien à l’entrepreneuriat et la création d’emplois pour les jeunes, en rappelant son importance stratégique pour le développement économique du pays. Depuis sa création, le FIGA s’impose comme un levier fondamental pour stimuler l’entrepreneuriat, réduire les barrières à l’accès au financement et accompagner les entrepreneurs à chaque étape de leur parcours. À ce jour, 7 097 jeunes ont été formés à l’élaboration de plans d’affaires et à la formalisation de leurs entreprises, tandis que 2 973 projets ont bénéficié d’un soutien financier grâce aux garanties de crédit offertes par le FIGA. Ces résultats démontrent son efficacité à transformer des idées en entreprises viables et à renforcer le tissu économique national. Un outil stratégique pour le Congo qui cherche à renforcer son tissu économique Le Président a rappelé que l’action du FIGA s’inscrit dans une vision ambitieuse pour l’avenir économique du Congo. Il a souligné son rôle clé dans la réinsertion de 20 000 jeunes dans le département du Pool, illustrant ainsi l’importance de ce fonds comme catalyseur de l’innovation et de l’autonomisation économique. Dans son intervention, celui-ci a déclaré : « Le FIGA est bien plus qu’un outil de financement. C’est un partenaire de transformation économique, conçu pour accompagner nos jeunes et nos entrepreneurs à réaliser leur potentiel et à contribuer activement au développement inclusif de notre pays. » Renforcer l’impact grâce à des partenariats stratégiques Pour maximiser son impact, le FIGA a noué des partenariats solides avec des institutions financières, des organisations de microfinance et des acteurs publics. Ces collaborations ont permis de sécuriser les financements, de partager les risques et d’assurer un accompagnement de qualité. À travers des initiatives comme la formation au sein des entreprises et les programmes d’accompagnement technique, le FIGA contribue à renforcer la résilience et la compétitivité des entrepreneurs congolais. “Nous croyons fermement que l’entrepreneuriat est une solution durable pour créer des emplois et réduire les inégalités économiques,” a ajouté M. Branham Kintombo, Directeur Général du FIGA. “Le rôle du FIGA est d’être un catalyseur pour nos entrepreneurs en les aidant à surmonter les défis financiers et techniques. Nous sommes convaincus que chaque projet soutenu contribue directement à la construction d’une économie congolaise plus inclusive, plus résiliente et tournée vers l’avenir.” Une action inscrite dans une stratégie de développement durable Avec un capital de 30 milliards de francs CFA, le FIGA offre des garanties financières adaptées et met en œuvre des programmes de renforcement des capacités. En 2024, il a intensifié ses efforts pour soutenir les jeunes entrepreneurs et les initiatives locales dans des secteurs stratégiques tels que l’agriculture, l’artisanat et les services. Grâce à des initiatives structurantes et des outils d’accompagnement sur mesure, le FIGA accompagne les entrepreneurs dans la formalisation et la réussite de leurs projets. Ces efforts s’inscrivent dans une dynamique globale visant à diversifier l’économie nationale et à offrir de réelles opportunités aux jeunes congolais.
Tunisie : la Banque africaine de développement mobilise plus de 92 millions d’euros pour renforcer la compétitivité des entreprises et l’autonomisation par l’emploi

Le Conseil d’administration de la Banque africaine de développement a approuvé un financement de 92,3 millions d’euros en faveur de la Tunisie pour mettre en œuvre le Programme d’appui à la compétitivité des entreprises et à l’autonomisation de la population par la création d’emplois (CAP Emplois). Le financement est composé, d’un prêt de 90 millions d’euros de la Banque et d’un don de quelque 2,3 millions d’euros provenant du fonds fiduciaire We-Fi (« Women Entrepreneurs Finance Initiative ») au titre de l’Initiative pour favoriser l’accès des femmes entrepreneures au financement (AFAWA, acronyme en anglais). Le programme CAP Emplois, conçu par le ministère tunisien de l’Emploi et de la Formation professionnelle avec l’appui de la Banque, sera déployé sur quatre ans à partir de novembre 2024. Il a pour objectif de renforcer la création d’emplois pour améliorer les conditions de vie de la population et promouvoir l’inclusion économique à travers l’entrepreneuriat et le développement des compétences. Il s’agit de favoriser la création de nouvelles entreprises, la croissance et la formalisation des entreprises existantes, et un meilleur accès à des emplois de qualité pour les jeunes et les femmes. « Les résultats du profil entrepreneurial de la Tunisie (une enquête réalisée par la Banque) montrent que les entrepreneurs potentiels et établis ont un grand potentiel en termes de création d’emplois, mais qu’ils font face à des contraintes structurelles qui affectent la réalisation de leur projet d’investissement, la productivité de leur entreprise et son potentiel de croissance. Ce projet contribue à la réponse à ces facteurs. », a noté Malinne Blomberg, la directrice générale adjointe de la Banque africaine de développement pour l’Afrique du Nord et responsable-pays pour la Tunisie. Parmi les contraintes qui freinent le développement des entrepreneurs tunisiens figurent notamment le niveau d’éducation, des problèmes d’accès au marché, en particulier pour les entreprises informelles. Les contraintes sont aussi liées aux difficultés à recruter des employés ayant les compétences nécessaires, un accès insuffisant à des services d’accompagnement et l’accès au financement. Le programme CAP Emplois a été conçu pour réduire ces contraintes à travers trois grands axes d’intervention. Premièrement, la formation complémentaire d’insertion (FCI) vise à transmettre aux jeunes et aux femmes en quête d’emploi, les compétences nécessaires pour accéder à des emplois salariés, notamment dans les très petites et moyennes entreprises (TPME) de leur région. Deuxièmement, l’appui à l’entreprenariat, Souk At Tanmia 2.0, a pour objectif d’étendre l’accès à des services d’accompagnement adaptés aux besoins de différentes cibles, notamment les femmes ; il vise aussi à faciliter l’accès au financement de la Banque Tunisienne de Solidarité (BTS) et à développer la formalisation des entreprises en réduisant les charges sociales et en appuyant les entrepreneurs dans la gestion et la productivité de leur entreprise. Troisièmement, le développement des capacités institutionnelles afin de maximiser l’impact des différentes interventions et de faciliter la conception et la mise en place de réformes pour améliorer le cadre réglementaire de l’entreprenariat. Selon les prévisions économiques du gouvernement tunisien, le programme pourrait contribuer à la création de 118 900 emplois formels, dont 76 600 directs et 42 300 indirects. Sur la question spécifique du genre, le programme CAP Emplois, contribuera à l’amélioration des indicateurs d’emploi pour les femmes par le développement des compétences et l’appui à l’entrepreneuriat féminin. Cela comprend l’organisation de formations et l’insertion professionnelle pour au moins 50 % de femmes, la création, la formalisation et le financement d’au moins 45 % d’entreprises portées par des femmes. Le don du fonds We-Fi au titre de l’initiative AFAWA allègera les frais d’initiation de prêt destinés aux entreprises féminines et permettra d’augmenter la part de femmes entrepreneures bénéficiaires de 35 % à 45 %. « Ce programme consolide notre engagement en Tunisie en matière de promotion de l’emploi en intégrant les enseignements tirés de l’initiative Souk At-Tanmia, et les innovations opérationnelles développées par la plateforme EInA. Il poursuit les objectifs suivants : lever les contraintes liées au passage à l’échelle et à la soutenabilité financière et générer un effet de levier sur l’investissement privé », a précisé Mme Blomberg.
Maroc/Observations de la Cour des comptes : L’action publique en matière d’emploi pointée du doigt

SPÉCIAL EMPLOI & POUVOIR D’ACHAT. « L’action publique en matière d’emploi, notamment l’insertion des jeunes, se caractérise par la multiplicité des acteurs qui interviennent à plusieurs niveaux, sans une définition claire et précise de leurs rôles et responsabilités et des relations qui les lient », avait déploré la Cour des comptes dans son rapport annuel au titre de 2022-2023 soutenant que cela impactait négativement la convergence et la coordination dans ce domaine. S’il est convenu que le ministère chargé de l’emploi a pour mission d’élaborer et de mettre en œuvre la politique publique dans le domaine de l’emploi conformément au décret n°2.14.280 fixant ses attributions, « la création d’emplois est liée principalement aux différentes stratégies sectorielles », avait indiqué le rapport. « D’où la nécessité de renforcer la coordination et la convergence en termes de fixation des objectifs relatifs à la création d’emplois et garantir leur réalisation », avait alors déduit l’Institution. Il se trouve que « les démarches suivies dans la planification de l’action publique en faveur de l’insertion des jeunes ne permettent pas la consolidation des efforts fournis à cet égard, et ce pour répondre aux spécificités et au caractère transversal de l’emploi », avait fait remarquer ledit rapport soulignant la non adoption de la stratégie nationale de l’emploi (2015-2025) par l’ensemble des parties concernées. Dans ce cadre, selon l’Institution publique, « la conception et l’évaluation du plan national de promotion de l’emploi (2017-2021) ont été marquées par des insuffisances liées principalement aux objectifs et réalisations en termes d’emplois créés ». Explication : pour la fixation de l’objectif lié à la création des postes d’emploi, il s’est limité à la consolidation des objectifs déclarés par les départements ministériels. La Cour des comptes signalait, à cet égard, que « certaines stratégies n’ont pas fixé d’objectifs globaux en termes de création d’emplois (comme la stratégie nationale de développement de la compétitivité logistique par exemple) et que certains secteurs n’ont pas été pris en compte par ledit plan malgré leur importance en matière de création d’emplois (à l’instar du secteur de la pêche) ». Autres griefs évoqués dans son rapport: le plan n’a pas fixé les rôles et les responsabilités des parties concernées ainsi que les ressources à mobiliser afin de mettre en œuvre les mesures préconisées. En conséquence, « cette situation a limité l’appropriation dudit plan par les autres départements ministériels, ce qui a impacté négativement sa mise en œuvre qui reste tributaire de l’engagement de tous les acteurs concernés », avait alors regretté le rapport. Alain Bouithy Lire également: Maroc/Chômage des jeunes. Cette épine que l’Exécutif peine trop à retirer Ni en emploi, ni en éducation, ni en formation: La situation des jeunes NEET au Maroc
Maroc. Le CESE plaide pour un investissement de meilleure qualité

Le rendement de l’investissement en termes de croissance et d’emploi demeure faible au Maroc. Un constat qui n’a visiblement pas échappé au Conseil économique, social et environnemental (CESE). Ce faible rendement « met en évidence l’impérieuse nécessité de promouvoir la qualité et l’efficacité de l’investissement, afin de propulser l’économie vers un palier de croissance plus élevé », a estimé l’institution constitutionnelle dirigée par Ahmed Réda Chami. Propulser l’économie vers un palier de croissance plus élevé C’est en faisant suite à ce constat que le Conseil « s’est penché sur les facteurs structurels et de gouvernance qui pourraient expliquer cette situation sous-optimale », a-t-il expliqué dans son 12ème rapport annuel. Sans omettre de souligner les efforts récents déployés pour accélérer la mise en place de dispositifs visant à promouvoir l’investissement privé, notamment la nouvelle Charte de l’investissement et le Fonds Mohammed VI pour l’investissement, le CESE a toutefois insisté sur « certains points-clés nécessitant une attention renforcée de la part des pouvoirs publics afin de maximiser les chances de succès de cette réforme ». Selon le document rendu public récemment, « une évaluation rigoureuse des dispositifs mis en œuvre exigera du temps, car elle ne pourra être effectuée qu’après avoir franchi la première étape d’implémentation ». C’est en se basant sur les constats relevés et analyses effectuées que l’institution a formulé un certain nombre de recommandations visant à promouvoir la qualité et l’efficacité de l’investissement et par ricochet de propulser l’économie vers un palier de croissance plus élevé. Dans un premier temps, le Conseil préconise de « garantir un suivi rigoureux de la mise en œuvre des actions prévues, jusqu’au niveau territorial le plus fin », estimant ainsi que des études d’impact basées sur des critères objectifs doivent être faites par une entité indépendante, afin de pouvoir apporter les ajustements nécessaires en temps opportun. L’institution estime aussi nécessaire d’assurer une cohérence et une synergie entre les objectifs et dispositifs de la Charte et ceux du Fonds Mohammed VI pour l’investissement, y compris entre les critères de définition des secteurs et les projets éligibles. Dans son rapport, le CESE recommande également davantage l’implication des représentants des TPME et entrepreneurs individuels dans la formulation et la mise à jour des politiques et mécanismes de promotion de l’investissement. Il appelle en outre « à prévoir des mécanismes d’appui dédiés au niveau de la Charte et du Fonds Mohammed VI pour l’incitation à la structuration et organisation des unités informelles ». L’institution plaide par ailleurs pour une révision du décret d’application de la Charte de l’investissement en y intégrant une prime favorisant le recrutement d’un quota de jeunes talents, similaire à la prime prévue pour encourager l’emploi féminin. Les recommandations du Conseil prévoient également de doter les centres régionaux d’investissement (CRI) de ressources humaines, logistiques et financières suffisantes pour leur permettre d’accomplir efficacement leur rôle. L’amélioration de l’accès aux facteurs de production (coût de l’énergie, foncier adapté aux petits investisseurs, formation du capital humain qualifié, etc.) permettra de réduire davantage les coûts de l’investissement et de la production dans les secteurs ciblés, a également soutenu le Conseil dans ledit rapport. Enfin, dans une optique de transparence et de lutte contre la corruption, le CESE appelle à accélérer le processus de généralisation de la digitalisation des procédures et à œuvrer pour une application effective et rigoureuse des règles de la concurrence. Alain Bouithy
L’adaptabilité des entreprises en période d’incertitude essentielle dans la préservation de l’emploi et le soutien à la croissance économique

L’adaptabilité et la planification stratégique des entreprises en période d’incertitude sont essentielles dans la préservation de l’emploi et le renforcement de l’expansion économique, souligne l’Organisation internationale du travail (OIT) dans un nouveau rapport. Selon le doucement rendu public récemment, « face aux multiples crises, la capacité d’adaptation des entreprises joue un rôle clé dans la sauvegarde de l’emploi et le soutien à la croissance économique ». « Dans une économie mondiale interconnectée, la robustesse des entreprises individuelles est directement corrélée à une croissance économique plus large et la reprise de l’emploi est grandement déterminée par l’environnement des affaires entourant les entreprises », écrit l’agence spécialisée des Nations unies dans l’avant-propos de son rapport intitulé « La résilience des entreprises avec le recul: les leçons de la pandémie de Covid-19 ». A ce propos, fait remarquer l’OIT, pendant la pandémie, les entreprises ont réalisé qu’elles étaient plus connectées que jamais, parfois d’une manière dont elles n’avaient même pas conscience. D’après le document, qui présente les expériences de chefs d’entreprise de divers secteurs et régions pendant la pandémie de COVID-19 afin de comprendre les stratégies qu’ils ont utilisées pour faire face à des défis sans précédent, les entreprises doivent se concentrer sur des aspects clés de leurs activités en temps de crise. « Il s’agit notamment de comprendre et de renforcer leurs chaînes d’approvisionnement mondiales, de travailler ensemble, de donner la priorité aux valeurs, d’utiliser la technologie à bon escient et de prendre des décisions rapides », selon les auteurs du rapport soutenant en outre que les entreprises qui ont adhéré à ces principes ont fait preuve de résilience et d’adaptabilité face aux défis auxquels elles ont été confrontées. Il faut dire que la capacité d’une entreprise à s’adapter, à se redresser et à prospérer après la crise n’a pas seulement un impact sur ses résultats, mais aussi sur le tissu socioéconomique au sens large, comme le relève le rapport. Ainsi que le souligne l’organisation internationale dans son avant-propos, « pour les nations et les économies, favoriser la résilience au sein de leurs communautés d’affaires est essentiel », et les leçons pratiques et les expériences du monde réel jouent un rôle déterminant à cet égard. Dans ce sens, elles permettent « aux chefs d’entreprise d’élaborer des stratégies de résilience commerciale qui garantissent que les entreprises ne sont pas de simples survivants, mais en ressortent mieux préparés aux crises futures ». Dans son rapport, l’agence onusienne insiste par ailleurs sur « l’importance de l’agilité des autorités publiques dans l’identification et l’atténuation des risques économiques systémiques, en particulier dans le contexte des perturbations de la chaîne d’approvisionnement », estimant que cette réactivité contraste fortement avec celle des crises précédentes. L’organisation consacrée à la promotion de la justice sociale et des droits du travail plaide ainsi pour une réglementation adaptative et une coopération internationale pour maintenir les frontières ouvertes et faciliter la poursuite des activités des entreprises. Mais avant de conclure, l’OIT prend la peine de rappeler que les personnes restent au cœur des entreprises, affirmant que « des valeurs telles que la confiance, l’équité et le bien-être mental ont joué un rôle clé dans la manière dont les entreprises ont été gérées pendant la pandémie ». Alain Bouithy