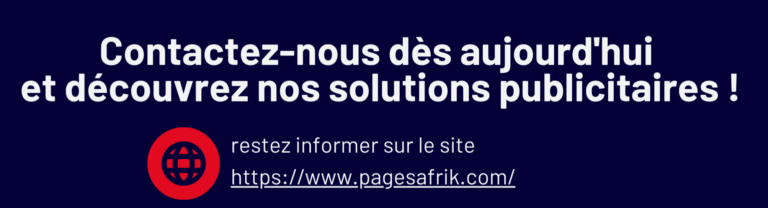Algérie. Le complexe Saidal lance la phase expérimentale du système de traçabilité séquentielle des médicaments : de la production à la commercialisation, jusqu’à la vente au consommateur

Le Ministre de l’Industrie et de la Production pharmaceutique, M. Ghrieb Sifi, a supervisé, lundi 27 janvier, au terme de sa visite d’inspection dans la wilaya de Tipaza, le lancement de la phase expérimentale du système de traçabilité séquentielle des médicaments, au niveau de l’unité de Cherchell relevant du complexe Saidal. M. Ghrieb était accompagné de la Ministre déléguée à la Haute Autorité de Numérisation, Mme Meriem Ben Miloud, du Ministre délégué auprès du Ministre de l’Industrie chargé de la Production Pharmaceutique, M. Fouad Hadji, du wali de Tipaza, M. Ali Moulay, et du président-directeur général du complexe Saidal, M. Wassim Kouidri. Le concept de traçabilité séquentielle des médicaments consiste à attribuer un identifiant unique (système séquentiel) à chaque unité de produits pharmaceutiques afin de les suivre tout au long de la chaîne d’approvisionnement, de la fabrication à la distribution et jusqu’au consommateur final. Cette initiative innovante vise à renforcer le système de suivi des produits pharmaceutiques et à garantir leur sécurité, conformément aux normes internationales, afin d’assurer la qualité des médicaments et de les protéger contre toute manipulation ou contrefaçon. Elle reflète également l’engagement du complexe Saidal à renforcer la confiance des consommateurs et des partenaires en proposant des solutions technologiques modernes pour améliorer l’efficacité de la chaîne d’approvisionnement. Dans son discours, le Ministre a salué les efforts du complexe Saidal pour adopter des technologies avancées contribuant à renforcer la sécurité sanitaire, à garantir la sécurité des patients et à pérenniser les produits pharmaceutiques algériens sur les marchés locaux et internationaux. Le Ministre a également appelé à généraliser cette initiative à d’autres producteurs de médicaments pharmaceutiques et a encouragé les start-ups à investir dans ce domaine. Il a insisté sur l’importance de partager les expériences avec l’établissement ayant réalisé ce projet, en vue de développer des solutions nouvelles et innovantes soutenant le système national de numérotation des produits pharmaceutiques. Le système de traçabilité séquentielle des médicaments représente un tournant majeur pour l’industrie pharmaceutique algérienne, permettant de suivre chaque produit depuis sa fabrication jusqu’à son arrivée chez le consommateur, renforçant ainsi la transparence et la crédibilité du secteur. En conclusion, le Ministre a exprimé son soutien continu au complexe Saidal, soulignant l’importance de mener cette expérience à bien et de généraliser le système à toutes les unités de production pharmaceutique.
Des dirigeants régionaux et internationaux du secteur privé, des gouvernements et du monde universitaire sont réunis à Addis-Abeba pour s’attaquer aux obstacles qui empêchent l’Afrique de fabriquer ses propres médicaments et vaccins
Une centaine de dirigeants du continent africain et d’autres régions, notamment des États-Unis et d’Europe, sont réunis, aujourd’hui et demain (lundi 25 et mardi 2, Dnr) à Addis-Abeba, pour une conférence axée sur la résolution des principaux défis en matière d’innovation et de transfert de technologie afin de renforcer le secteur pharmaceutique en Afrique. Les thèmes abordés vont de la sécurité de l’approvisionnement régional aux lacunes technologiques dans le développement du secteur privé et la recherche et développement du secteur public, en passant par la quête d’un juste équilibre entre les droits de propriété intellectuelle et l’accès pendant et après les pandémies. Les panélistes examinent également de nouveaux modèles de financement pour stimuler l’investissement dans le secteur. « Cette conférence est la première du genre en Afrique à examiner les obstacles à la fabrication et à la production nationales de produits de santé essentiels pour le continent », a déclaré Padmashree Gehl Sampath, la directrice générale de la nouvelle Fondation africaine pour la technologie pharmaceutique (APTF). Présentant la vision de l’APTF, Mme Gehl Sampath a déclaré que l’agence souhaitait « une industrie pharmaceutique africaine dynamique, capable de fabriquer des produits pharmaceutiques et d’innover en la matière en Afrique, pour le peuple africain ». Elle a ajouté que la fondation aspirait à « passer de 400 sociétés à au moins 800 sociétés pharmaceutiques dans la région d’ici à 2040 ». Les débats des sept sessions, qui se déroulent aujourd’hui et demain, sont ouverts par des discours liminaires de Mekdas Daba Feyssa, ministre éthiopien de la Santé, Monique Nsanzabaganwe, présidente de la Commission de l’Union africaine, Ahmed Ogwell Ouma, directeur général adjoint d’Africa CDC, Edward Kwakwa, sous-directeur général de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, Michel Sidibé, envoyé spécial de l’Union africaine auprès de l’Agence africaine de médicaments, et Oyebanji Oyelaran-Oyeyinka, conseiller spécial principal du président de la Banque africaine de développement. Le premier jour a débuté par la diffusion d’enregistrements vidéo d’allocutions de bienvenue de la part du directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, de la directrice générale de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), Ngozi Okonjo-Iweala, et du président du Groupe de la Banque africaine de développement, Akinwumi Adesina(le lien est externe), apportant leur soutien aux discussions. « L’accès aux produits de santé est une composante essentielle de la couverture sanitaire universelle et de la sécurité sanitaire, a souligné le Dr. Tedros de l’OMS. Merci pour votre engagement en faveur d’un secteur pharmaceutique plus fort sur le continent ». « De multiples étoiles s’alignent dans le paysage mondial afin que le continent attire des investissements nationaux et internationaux pour construire des chaînes de valeur et une base manufacturière solide dans ce secteur », a déclaré Ngozi Okonjo-Iweala. Les entreprises devraient essayer de prendre une longueur d’avance… établir des partenariats et travailler sur des licences volontaires… [qui] s’accompagnent d’un véritable transfert de technologie. L’APTF a un rôle important à jouer dans tout cela ». L’Afrique importe plus de 70 % de ses besoins en matière de santé, ce qui représente un coût annuel de près de 14 milliards de dollars. Le continent ne mène que 2 % de la recherche mondiale sur les nouvelles infections, bien qu’il supporte un quart du fardeau mondial des maladies. Pour inverser cette tendance, l’Afrique devra, entre autres mesures nécessaires, surmonter les obstacles à l’accès aux technologies dans les secteurs public et privé du continent. Parmi les organisations présentes à la conférence figurent la Fondation Science pour l’Afrique, la Communauté des brevets sur les médicaments, le National Vaccine Institute du Ghana, l’African Vaccine Manufacturing Initiative, les Partenariats pour la fabrication de vaccins en Afrique, l’initiative Médicaments contre les maladies négligées, le Centre d’excellence africain pour la génomique des maladies infectieuses, l’institut de recherche sur les virus de l’Ouganda, le Regionalized Vaccine Manufacturing Collaborative, la Zone de libre-échange continentale africaine, Unitaid et la Fédération internationale des fabricants et associations pharmaceutiques. Des cadres dirigeants de sociétés africaines pharmaceutiques, biotechnologiques et de vaccins, ainsi que des universitaires de renommée mondiale, participent également à la conférence. « L’Afrique doit changer son environnement technologique […] et construire un écosystème de recherche et développement pharmaceutique et biomédical capable de soutenir des industries pharmaceutiques locales de classe mondiale », a appelé Akinwumi Adesina. « Nous étions convaincus que cela ne pourrait se faire qu’avec une institution dédiée, œuvrant à promouvoir le changement et à faciliter l’accès à la technologie. C’est pourquoi la Banque africaine de développement a créé l’APTF avec le soutien de l’Union africaine », a-t-il expliqué. Créée en 2022 en tant qu’agence régionale indépendante, l’APTF s’efforce d’améliorer l’accès de l’Afrique aux technologies nécessaires à la découverte, au développement et à la fabrication de médicaments, de vaccins et de diagnostics. La Fondation aide les entreprises africaines à s’engager dans des transactions technologiques, à commercialiser la propriété intellectuelle et à diversifier les porteuilles de produits, les instituts de recherche à devenir des centres d’excellence et les gouvernements à façonner des marchés de produits sains, entre autres initiatives. Devex, une plateforme médiatique pour la communauté mondiale du développement, a récemment désigné la Fondation africaine pour la technologie pharmaceutique comme l’une des 24 agences à suivre dans le monde en 2024. « L’APTF va changer la donne, a affirmé Oyebanji Oyelaran-Oyeyinka, conseiller spécial principal du président de la Banque africaine de développement. Son objectif est de changer la manière dont les entreprises internationales établissent des relations et des partenariats avec les entreprises africaines. La Fondation facilitera l’entrée dans la région et éliminera les barrières structurelles, réglementaires et institutionnelles de manière à accélérer les projets de production nationale en collaboration. » La conférence internationale sur l’innovation, la propriété intellectuelle et le transfert de technologie dans le secteur pharmaceutique en Afrique est soutenue par le ministère allemand de la Coopération et du Développement.
CICR/Libye : distribution de médicaments, de vivres, d’articles ménagers et de sacs mortuaires pour aider les milliers de personnes frappées par les violentes inondations
Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) s’apprête à distribuer des médicaments, des vivres, des sacs mortuaires, des trousses de premiers secours et des articles ménagers aux communautés sinistrées en Libye pour aider les milliers de familles qui en ont cruellement besoin après les inondations dévastatrices qui ont frappé le nord-est du pays. Le CICR a dépêché des équipes supplémentaires dans la région pour procéder à la distribution de l’aide humanitaire. Il a également renforcé son équipe d’experts forensiques basée à Benghazi et fourni 6000 sacs mortuaires aux autorités et au Croissant-Rouge libyen pour leur permettre d’assurer une gestion digne des corps des victimes. « Cette catastrophe a été soudaine et brutale. Une vague de sept mètres de haut s’est abattue sur Derna, emportant immeubles et infrastructures vers la mer. De nombreuses maisons ont été détruites et beaucoup de personnes sont encore portées disparues, tandis que des corps commencent à venir s’échouer sur le rivage. Les habitants de la ville ont subi un immense choc émotionnel », a indiqué Yann Fridez, chef de la délégation du CICR en Libye, dont une équipe se trouvait à Derna pour des projets micro-économiques en faveur des familles au moment où les eaux ont balayé la ville. Des sets d’ustensiles de cuisine, des matelas et des articles d’hygiène seront distribués à Derna dans les semaines à venir, en coopération avec le Croissant-Rouge libyen. Des médicaments seront également remis aux autorités et à la Société nationale ces prochains jours. L’accès aux zones touchées par les inondations est l’un des principaux défis pour les secours humanitaires, les routes ayant été détruites ou sérieusement endommagées. Le CICR s’emploie par ailleurs à évaluer les risques liés aux restes explosifs de guerre et aux dépôts de munitions abandonnés à Derna, une menace supplémentaire pour les habitants, les secouristes et les autorités qui s’efforcent de faire face à la situation. « Il est encourageant de voir qu’il y a un véritable esprit d’entraide entre la population et les autorités, qui unissent leurs efforts pour apporter toute l’assistance possible. Mais le chemin est encore long. Il faudra de nombreux mois, voire des années, pour que les habitants puissent se relever de dégâts d’une telle ampleur », a ajouté M. Fridez.
US-Africa Summit Business Summit 2022: L’Afrique invitée à renforcer sa production locale de médicaments
Les travaux de la 14e édition de l’US-Africa Business Summit, qui se tient, du 19 au 22 juillet à Marrakech sous l’initiative du «Corporate Council on Africa» (CCA), se poursuivent avec l’organisation de réunions de haut niveau qui ont pu traiter de différentes thématiques qui sont d’actualité au sein du continent africain. Parmi les thématiques clés qui furent abordées dans le cadre de ces réunions, on retrouve celle liée au fait de «doter l’Afrique d’une capacité à produire localement des médicaments». Aujourd’hui, près de 95 % de tous les médicaments utilisés en Afrique sont importés. Dans ce contexte, le continent ne représente que 3 % de la production mondiale de médicaments. La pandémie de COVID-19 a d’ailleurs fortement contribué à mettre à nue les vulnérabilités de l’Afrique en matière d’accès aux médicaments, aux vaccins et aux technologies de santé vitales et de plus en plus de gouvernements africains considèrent la fourniture de médicaments et de vaccins sûrs, efficaces et abordables comme une question de sécurité nationale. Tous les intervenants à cette réunion de haut niveau furent unanimes pour dire que la stimulation de la production locale permettra de sauver des vies, d’améliorer la santé publique et de renforcer les économies africaines, notamment en soutenant les emplois locaux. Elle devrait également déclencher le partage de technologies cruciales.
Hausse des prix des médicaments : l’OCDE prône une nouvelle approche dans un nouveau rapport

Selon l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), la multiplication de médicaments très onéreux et la hausse des prix des médicaments sont à l’origine de pressions de plus en plus lourdes sur les dépenses publiques de santé. L’organisation affirme dans un nouveau rapport, « La gestion des nouvelles technologies de santé – Concilier accès, valeur et viabilité », que ces évolutions conduisent à remettre en question les stratégies tarifaires de l’industrie pharmaceutique. Pour faire face à la hausse des prix des médicaments, l’OCDE exhorte les pouvoirs publics à collaborer avec les industriels et les instances de réglementation « pour définir une nouvelle approche de la mise au point et de l’utilisation des nouvelles technologies de santé propre à encourager l’innovation tout en favorisant l’émergence de traitements plus abordables et d’un meilleur rapport qualité-prix ». Dans ce rapport, l’organisation fait remarquer que les dépenses pharmaceutiques sont de plus en plus consacrées à des produits ayant un coût élevé. Le document révèle aussi que les prix de lancement des médicaments visant à traiter le cancer et les maladies rares sont en augmentation, quelquefois sans que l’on observe une hausse du même ordre de leurs bénéfices pour la santé des patients. Citant le cas des États-Unis, l’OCDE note que « le prix de lancement des médicaments de la classe des anticancéreux par année de vie gagnée a été multiplié par quatre en moins de vingt ans (en données constantes) et dépasse aujourd’hui les 200 000 USD » L’autre problème révélé dans ce document, celui des organismes payeurs, compagnies d’assurance ou prestataires publics de services de santé qui auraient de « plus en plus de difficultés à prendre en charge le coût élevé des médicaments destinés à des populations peu nombreuses, dont le nombre devrait croître fortement avec le développement de la médecine de précision ». Ce n’est pas tout. L’OCDE constate également que « les nouveaux traitements de l’hépatite, qui sont très efficaces et d’un bon rapport qualité-prix à long terme mais qui ciblent une large population, sont inabordables pour bien des malades qui pourraient en bénéficier dans la quasi-totalité des pays de l’OCDE, à cause de leur impact très lourd sur les budgets », déplore-t-il. Cette situation ne plaît visiblement pas à l’organisation qui estime que « le prix des technologies doit refléter les bénéfices que celles-ci apportent concrètement en termes de santé par rapport à d’autres possibilités, et ce prix doit être ajusté en fonction des preuves de leur impact réel ». par ailleurs, poursuit-elle, les organismes payeurs doivent être dotés des pouvoirs nécessaires pour en ajuster les prix et cesser de les rembourser en cas d’inefficacité. En conséquence, l’OCDE estime qu’un rééquilibrage s’impose entre le pouvoir de négociations des organismes payeurs et celui des producteurs, selon le rapport. Précisions : « ce rééquilibrage pourrait être facilité par une plus grande transparence et un renforcement de la coopération entre les organismes payeurs et des initiatives internationales d’achats groupés, comme cela a été testé en Europe et en Amérique latine ». Autres suggestions, « les accords de tarification en vertu desquels le prix final d’un médicament est lié à ses performances effectives, comme ceux qui existent en Italie et en Angleterre, pourraient aussi être efficaces, pour autant que les coûts de gestion et les coûts administratifs soient maîtrisés et que les données et observations cliniques soient mises largement à la disposition de la communauté scientifique ».