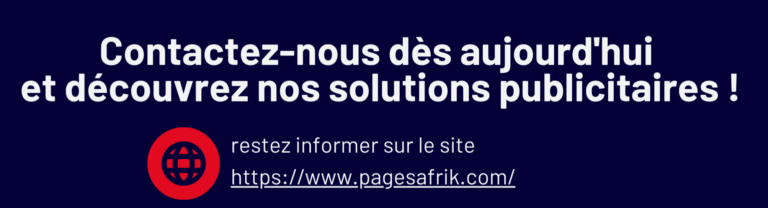RDC. Les travers suite aux inondations kinoises…

PARLONS-EN. Les inondations suite aux pluies diluviennes qui se sont abattues sur la capitale congolaise n’ont pas fait que des malheureux. Il y en a qui en ont tiré un profit maximal. En voilà quelques exemples-types. 1. Hier matin nous étions émerveillés par la justesse de la décision prise par le gouvernement pour disponibiliser les navettes pour transporter les voyageurs par la voie fluviale. Les organisateurs en ont fait leurs choux gras. Ils ont monté les enchères jusqu’à taxer à 200 $ un petit voyage qui d’ordinaire ne coûte que 15$. 2. Pour atteindre l’aéroport de N’djili, certains passagers ont embarqué à bord d’un petit porteur à partir de l’aérodrome de Ndolo. Un vol de 5 minutes facturé entre 120 à 150 Usd par siège. Et tenez-vous bien: beaucoup parmi eux ont été contraints de payer 15$ de GOPASS pour un si petit trajet local. 3. Quelle n’a pas été notre joie de voir le gouverneur de la ville de Kinshasa sillonner des rues sinistrées de sa ville dans un hors-bord! Puis patatras ! Cette scène rocambolesque du hors-bord tombé en panne avrc dedans le gouverneur mobilisé au milieu des eaux en furie. Même scène par ailleurs avec un groupe de passagers ayant pris une navette à Gombe en direction de l’aéroport et qui se sont retrouvés bloqués sur le fleuve Congo suite au moteur de la navette qui s’est brusquement arrêté. Faut-il encore des preuves supplémentaires pour démontrer que ces engins de l’Onatra ne connaissent plus d’entretien technique depuis belles lurettes. 4. Un fait a échappé à l’attention du commun de mortel : le nombre ahurissant des bouteilles plastiques qui ont inondé la station de purification d’eau de Regideso située juste en aval du pont de la rivière Ndjili. Tout était couvert de ces détritus non biodégradables que les congolais ont pris la triste habitude de jeter partout. Ces bouteilles plastiques sont en train de prendre tout le lit de rivières congolaises et faute d’un travail de curage ou de druggage, il faudra nous attendre au pire dans les jours qui viennent. Une ville de plus 14 millions d’habitants sans un service sérieux de sapeurs-pompiers ni de secours civils d’intervention rapide avec des moyens conséquents tels des hélicoptères et des canots de de sauvetage court d’énormes risques en termes de pertes en vie humaine et en dégâts matériels. Chaque commune devait en être dotée. Quelqu’un peut m’expliquer ce que l’hôtel de ville fait de tous ces millions des contribuables??? Par Germain Nzinga
RDC : Ces inondations et leurs effets collatéraux

SOCIETE. C’est depuis trois semaines maintenant que les crues de rivières et du fleuve Congo continuent à faire des dégâts. Rien que pour le majestueux fleuve Congo, l’eau est montée de 6 m de son niveau habituel, rasant de la carte géographique la cité du Fleuve, l’île de Mbamou dans le Congo voisin, une bonne partie des ports de l’Onatra à Kinshasa et à Matadi, des villages et quartiers entiers à Mbudi, à Luozi et ailleurs. Les dégâts ne se limitent pas seulement à ces maisons immergées. A moyen et long terme, il faudra s’attendre à ce que de nombreuses familles soient sans logis et viennent aggraver la situation déjà précaire de l’habitat dans les grandes agglomérations. Il faut également soulever le fait que ces inondations avec ces eaux se mêlant aux différents déchets, y compris ceux de WC, transportent des maladies d’origine hydrique telles que le choléra, la fièvre typhoïde, l’hépatite A, la giardiase, la cryptosporidiose, l’amibiase, etc. L’approvisionnement en eau d’une région peut lui-même se retrouver pollué par les eaux de crue, entraînant des maladies et des épidémies de toute sorte. Toujours les mêmes inondations rendent également vulnérables les différents réseaux : réseaux de transports, d’énergies, de télécommunications, d’eau potable et d’eaux usées. Les mêmes eaux sales transportent souvent des produits chimiques qui peuvent affecter la qualité du sol dans l’environnement. Cette pollution peut provoquer des mortalités de la faune et de la flore, et une pollution des milieux qui peut perdurer longtemps après le retrait des eaux. Ainsi donc, lorsque les eaux reprendront leur lit des rivières, puissent les pouvoirs publics veiller à ce que ni la santé publique ni l’environnement général ne se détériorent davantage. Par Germain Nzinga
Les inondations en Somalie font 100 morts (OCHA)
Des inondations causées par de fortes pluies ont fait près de 100 morts et quelque 750.000 sans-abri en Somalie, a déclaré vendredi le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l’ONU (OCHA). « Le pays est au milieu d’une catastrophe, alors que les pluies dévastatrices et les inondations se propagent », a déclaré l’agence. La plupart des personnes touchées par les pluies torrentielles et les crues soudaines et fluviales se trouvent dans les Etats du Sud-Ouest, de Galmudug, du Puntland, de Hirshabelle et de Jubaland, ainsi que dans la région de Banadir, a indiqué l’OCHA. L’agence humanitaire de l’ONU a déclaré que cette catastrophe survenait alors que des millions de Somaliens continuent de lutter contre la faim et la malnutrition, avec une estimation de 1,5 million d’enfants de moins de cinq ans confrontés à une malnutrition aigüe entre août 2023 et juillet 2024. L’agence a déclaré qu’en dépit des besoins massifs, le plan de réponse humanitaire pour la Somalie en 2023, qui nécessite plus de 2,6 milliards de dollars pour répondre aux besoins prioritaires de 7,6 millions de personnes, n’était financé qu’à 42%, soit 1 milliard de dollars. « Les organisations humanitaires ne peuvent pas répondre aux besoins actuels et nouveaux sans ressources supplémentaires », a ajouté l’OCHA.
CICR/Libye : distribution de médicaments, de vivres, d’articles ménagers et de sacs mortuaires pour aider les milliers de personnes frappées par les violentes inondations
Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) s’apprête à distribuer des médicaments, des vivres, des sacs mortuaires, des trousses de premiers secours et des articles ménagers aux communautés sinistrées en Libye pour aider les milliers de familles qui en ont cruellement besoin après les inondations dévastatrices qui ont frappé le nord-est du pays. Le CICR a dépêché des équipes supplémentaires dans la région pour procéder à la distribution de l’aide humanitaire. Il a également renforcé son équipe d’experts forensiques basée à Benghazi et fourni 6000 sacs mortuaires aux autorités et au Croissant-Rouge libyen pour leur permettre d’assurer une gestion digne des corps des victimes. « Cette catastrophe a été soudaine et brutale. Une vague de sept mètres de haut s’est abattue sur Derna, emportant immeubles et infrastructures vers la mer. De nombreuses maisons ont été détruites et beaucoup de personnes sont encore portées disparues, tandis que des corps commencent à venir s’échouer sur le rivage. Les habitants de la ville ont subi un immense choc émotionnel », a indiqué Yann Fridez, chef de la délégation du CICR en Libye, dont une équipe se trouvait à Derna pour des projets micro-économiques en faveur des familles au moment où les eaux ont balayé la ville. Des sets d’ustensiles de cuisine, des matelas et des articles d’hygiène seront distribués à Derna dans les semaines à venir, en coopération avec le Croissant-Rouge libyen. Des médicaments seront également remis aux autorités et à la Société nationale ces prochains jours. L’accès aux zones touchées par les inondations est l’un des principaux défis pour les secours humanitaires, les routes ayant été détruites ou sérieusement endommagées. Le CICR s’emploie par ailleurs à évaluer les risques liés aux restes explosifs de guerre et aux dépôts de munitions abandonnés à Derna, une menace supplémentaire pour les habitants, les secouristes et les autorités qui s’efforcent de faire face à la situation. « Il est encourageant de voir qu’il y a un véritable esprit d’entraide entre la population et les autorités, qui unissent leurs efforts pour apporter toute l’assistance possible. Mais le chemin est encore long. Il faudra de nombreux mois, voire des années, pour que les habitants puissent se relever de dégâts d’une telle ampleur », a ajouté M. Fridez.
Les inondations et l’instabilité de l’environnement sécuritaire ont freiné la reprise économique attendue du Tchad, selon la Banque mondiale

Le Tchad a connu une croissance modeste de son PIB en 2022 du fait des inondations et de l’instabilité de l’environnement sécuritaire qui ont freiné la reprise attendue indique la Banque mondiale dans un rapport publié à l’occasion de la troisième édition de la « Semaine du savoir », un atelier de dissémination des rapports portant sur des questions de croissance et développement clés au Tchad. Après une contraction de 1,2 % en 2021 (-4,3 % par habitant), l’économie tchadienne devait se redresser en 2022 grâce aux prix élevés du pétrole, à l’augmentation de la production pétrolière et à la dépréciation du taux de change FCFA/USD. Cependant, la reprise a été ralentie par les inondations et un environnement sécuritaire volatile, avec une croissance du PIB estimée à 2,2 % (-0,9 % par habitant), et une croissance du PIB non pétrolier de 1,3 %, contre 0,4 % en 2021. L’industrie (principalement le secteur pétrolier) a été le principal contributeur à la croissance (4,1 points de pourcentage), suivie par l’agriculture avec une contribution de 0,6 point de pourcentage, en raison d’une distribution inadéquate des précipitations et de graves inondations. La semaine du savoir intitulée « Aider le Tchad à être résilient face aux chocs climatiques », a pour objectif de nourrir le débat public sur les développements économiques récents et perspectives en matière de politiques macroéconomiques et sociales en faveur de la croissance et de la réduction de la pauvreté. « Le thème de cette semaine du savoir est en parfaite harmonie avec la note d’engagement pays élaborée pour accompagner le Tchad pendant cette période charnière qu’il traverse. Et ces deux rapports coïncident avec les efforts conjoints menés par la Banque mondiale et le gouvernement sur les questions de lutte contre la pauvreté et de changement climatique ainsi que d’investissements pour une croissance inclusive », explique Rasit Pertev, Représentant résident de la Banque mondiale pour le Tchad. Au cours de cet évènement, la Banque présentera deux nouveaux rapports : Ces deux rapports mettent en exergue le double défi climatique et sécuritaire auxquels le Tchad fait face. « La mise en œuvre de réformes politiques ciblées sera essentielle pour renforcer la capacité du Tchad à s’adapter aux inondations et à en réduire l’impact », indique Claudia Noumedem Temgoua, économiste pays à la Banque mondiale et coordonnatrice de la « semaine du savoir ».
MSF : les inondations à N’Djamena renforcent la crise humanitaire et font craindre l’apparition d’épidémies

Depuis mi-août, le centre et le sud du Tchad sont frappés par des graves inondations, les dernières touchant la capitale, N’Djamena, où deux fleuves ont débordé, laissant des quartiers entiers submergés par les eaux. L’organisation internationale médicale Médecins Sans Frontières (MSF) a mis en place une réponse d’urgence pour faire face aux besoins les plus pressants des personnes ne disposant que d’un accès minimal aux services essentiels, et exposées à des risques accrus d’épidémies. « Les dernières inondations viennent aggraver une situation humanitaire déjà terrible, explique Alexis Balekage, coordinateur du projet d’urgence MSF à N’Djamena. Le Tchad connait chaque année des inondations, mais en 2022, un nouveau seuil est franchi. Les crues ont conduit à des déplacements de populations à grande échelle et ont engendré des besoins immenses dépassant largement la réponse actuelle, le tout dans un pays qui continue d’être quasi invisible sur la scène internationale. » La récente et dramatique montée du niveau des fleuves Chari et Logone, qui ont atteint jusqu’à 8,14 mètres près de leur confluence à N’Djamena, et qui a les faits déborder, est attribuée à des chutes de pluies exceptionnellement fortes dans le sud du pays. Au 15 novembre, plus de 155 000 habitants de la capitale ont été forcés de quitter leur foyer à cause des inondations, selon les Nations Unies. Ces personnes ont trouvé refuge dans différents sites de déplacés officiels ou informels. Cela les éloigne davantage des services essentiels, ce qui les rend plus vulnérables à des risques de santé sérieux, en particulier dans un contexte de pic saisonnier du paludisme. « Les personnes déplacées vivent dans des conditions précaires et parfois de surpeuplement, avec un accès restreint à l’eau potable, à la nourriture et à une hygiène correcte, continue Alexis Balekage. Les eaux stagnantes risquent de devenir un lieu de reproduction pour les moustiques, ce qui va probablement favoriser la transmission du paludisme, une des premières causes de mortalité au Tchad. Nous craignons également l’apparition et la propagation d’autres maladies hydriques et infectieuses si le niveau des eaux ne diminue pas rapidement et que la réponse humanitaire n’est pas renforcée afin de subvenir aux besoins des populations. » Depuis plusieurs semaines, des maisons, des écoles, des structures de santé et des marchés sont complètement submergés par les eaux. Des personnes utilisent des canoës pour rejoindre certains quartiers inondés, et ces embarcations sont perçues par les hippopotames comme des dangers qu’ils attaquent. En une semaine seulement, cinq personnes, dont une femme enceinte, ont perdu la vie pour cette raison. Les inondations ont également touché des infrastructures vitales comme le réseau d’approvisionnement en eau et les routes, et entraînent des conséquences graves sur les moyens de subsistance d’une population dépendant grandement de l’agriculture. Plus de 465 000 hectares de plantations ont ainsi été endommagés et plus de 19 000 têtes de bétail sont mortes, occasionnant des inquiétudes quant à la production agricole et à la sécurité alimentaire. « Notre maison a été inondée. Dans les chambres, l’eau a atteint 1,2 mètre, témoigne Doglessa, qui a trouvé refuge dans le site de Walia Hadjarai, à N’Djamena. Ma famille et moi sommes partis ensemble. Nous vivons maintenant dans une tente, exposés au froid, aux moustiques et à tous les autres dangers. Notre unique hectare de riz a été englouti par les eaux et je suis donc sans emploi. A cause des inondations, nous ne pouvons pas nous rendre rapidement dans un centre de santé pour y voir un docteur. De plus, la consultation n‘est pas gratuite et cela pose des problèmes alors que je suis sans revenu. Mon plus grand souhait est que le niveau des eaux baisse au plus vite pour que nous puissions rentrer chez nous. » A Toukra, dans le sud de la capitale, un centre de santé soutenu par MSF a été complètement inondé, obligeant le personnel à transférer les patients et les activités dans un autre centre de soins. Les équipes MSF, en collaboration avec le Ministère de la Santé, mènent des cliniques mobiles dans les sites d’accueil des sinistrés et appuient des centres médicaux existants à proximité, comme dans les sites de Toukra, Ngueli, Guilmey, Melezi, Digangali, Karkanjeri, Miskine, Walia-Hadjarai et le lycée de Walia. En plus des soins de santé générale, d’un soutien nutritionnel et vaccinal, elles fournissent des services d’eau et d’assainissement. Durant les dernières semaines, les équipes MSF ont effectué plus de 15,500 consultations, principalement des cas de paludisme, d’infections respiratoires et de diarrhées. Au moins 80 patients ont également été transférés à l’hôpital pour des soins spécialisés et 345 bébés ont été vaccinés contre des maladies infantiles courantes. Les équipes ont également fourni de l’eau potable ainsi que des biens de première nécessité, incluant des kits d’hygiènes et des kits de prévention du paludisme, aux familles déplacées. Depuis début 2022, le Tchad est victime de conditions météorologiques extrêmes en lien avec le changement climatique, et cela prend la forme de graves sécheresses et de précipitations irrégulières. Selon les autorités de santé locales, plus d’un million de personnes à travers 18 des 23 régions du pays ont été affectées. « Si l’on observe en particulier la situation à N’Djamena, nous anticipons que les conséquences dramatiques des inondations perdureront de nombreuses semaines encore, confie Sami Al Subaihi, Chef de Mission pour MSF au Tchad. Comme le niveau des eaux baisse lentement, il n’y a malheureusement pas de raison de penser que la situation va s’améliorer dans un avenir proche, ni même que les personnes pourront retourner chez elles. La réponse d’urgence MSF a pour but de subvenir aux besoins immédiats des populations, mais il est impératif de mobiliser des fonds additionnels ainsi que de développer un programme à plus long terme qu’une réponse durable et adaptées à cette crise puisse voir le jour. »
RD Congo. Retour sur les inondations à Kinshasa

SOCIETE. Kinshasa est l’une des rares villes au monde traversée de part et d’autre par 24 rivières et par un puissant fleuve avec son débit de 80.832 m3 par seconde au maximum. Outre les deux grandes rivières de Ndjili et de Nsele qui résistent encore à la pression humaine de la pollution, toutes les vingt-deux autres sont carrément étouffées dans leur lit par les déchets non biodégradables que les populations kinoises ont pris la triste habitude de jeter dans ces cours d’eau. Ces bouteilles plastiques et tant d’autres déchèteries remplissent tant les caniveaux que les cours d’eau où ils sont appelés à se déverser et, à la première précipitation, les furieuses eaux de pluie ne sachant par où couler, se déversent dans les rues et inondent les habitations comme nous avons pu le constater cette semaine. En tirant les oreilles aux populations qui commettent la grave erreur de jeter les déchets n’importe où, c’est surtout aux services publics de l’Etat congolais que revient la première responsabilité. Car c’est l’Etat congolais qui est aménageur des espaces et pourvoyeur des services pour la qualité de vie dans les espaces habités. À Kinshasa fort malheureusement, règne le non planifié, la jungle, l’air de la faillite de l’état dans le mode de gestion du milieu de vie des populations. Ni le gouverneur actuel plus versé dans la campagne présidentielle en faveur du régime actuel ni le président de l’assemblée provinciale dont les kinois n’attendent plus rien sinon la galerie des photos personnelles chaque dimanche soir, aucune autorité de cette ville n’en maîtrise les ficelles de l’administration. Et tenez-vous bien : le danger peut bien être devant nous. Car selon les dernières projections de la CIA ( cfr « Le monde en 2040 vu par la CIA » publié tout récemment en avril 2022) la ville de Kinshasa à l’horizon 2040 sera la mégapole africaine la plus peuplée avec 28 à 30 millions d’habitants, bien avant Lagos et Le Caire. Si rien n’est fait en terme de gestion de la voirie et de l’urbanisme, la situation pourra devenir simplement incontrôlable. Ainsi donc renforcer les capacités de la voirie urbaine, la doter des outils performants de travail et d’un personnel bien formé quant à ce, mettre de l’ordre dans le fonctionnement des services de l’urbanisme et habitat en vue de bannir les constructions anarchiques, procéder une fois le mois au curage de 24 rivières traversant la capitale kinoise, réorganiser méthodiquement la récolte des déchets domestiques et leur recyclage, voilà des pistes qui peuvent nous éviter des scènes hallucinantes auxquelles nous avons été exposés cette semaine. “Gouverner, c’est prévoir”, ne l’oublions point. Par Germain Nzinga
Côte d’Ivoire : un prêt de 48 millions d’euros de la Banque africaine de développement pour lutter contre les inondations et améliorer le cadre de vie des populations du District autonome d’Abidjan
Le Conseil d’administration de la Banque africaine de développement a accordé, mercredi (15 septembre, dnr) à Abidjan, un prêt de 48,4 millions d’euros à la Côte d’Ivoire, pour le financement et la mise en œuvre du Projet d’assainissement et d’amélioration du cadre de vie du District autonome d’Abidjan (PAACA). Ce projet, prévu pour une période de cinq ans, prolonge le Projet de gestion intégrée du bassin versant du Gourou, financé par la Banque et clôturé en décembre 2017. Ce dernier projet a permis, entre autres, une meilleure régulation de l’évacuation des eaux pluviales dans la capitale économique ivoirienne et surtout la réduction des inondations au niveau du Carrefour de l’Indénié. D’importantes réalisations sont attendues au cours de la mise en œuvre du PAACA : réhabilitation et extension de 82,15 kilomètres de réseaux d’assainissement des eaux usées dans les zones nord et sud de la ville ; réalisation de 16,15 kilomètres de canaux de drainage des eaux pluviales ; mise en place de 2 700 branchements sociaux pour les ménages vulnérables sur le réseau des eaux usées ; aménagement d’un jardin public et réhabilitation de trois centres de santé raccordés au réseau d’eau potable. Pour les ménages, les écoles et centres de santé, un millier de branchements en eau potable seront réalisés pour améliorer l’accès à l’eau potable. Seront également construits 429 latrines scolaires et publiques, deux hangars et aires de séchage pour le fumage des poissons, cinq unités de fabrication d’attiéké (semoule de manioc). Enfin, des équipements de gestion des déchets solides seront mis en place avec un accompagnement à la formation des pré-collecteurs. « Un important volet IEC (information, éducation, communication) sera également développé pour sensibiliser les populations sur la gestion des ouvrages d’assainissement, l’hygiène, la santé et les amener ainsi à un changement de comportement par rapport à l’assainissement et au cadre de vie », a ajouté Marie-Laure Akin Olugbade, directrice pour l’Afrique de l’ouest de la Banque africaine de développement. Par ailleurs, a indiqué Osward Chanda, Directeur du département eau et assainissement à la Banque, il est prévu de réaliser une étude sur l’analyse de la vulnérabilité aux risques hydro-climatiques de la ville d’Abidjan. Cette étude s’intéressera également à la question de l’élévation du niveau de la mer. Des activités seront identifiées à travers le développement d’un projet à soumettre au Fonds vert pour le Climat sur la base des résultats de cette étude et celles sur la gestion et la valorisation des déchets solides. La zone d’intervention du projet couvrira plusieurs communes du district d’Abidjan : Adjamé, Attécoubé, Abobo, Cocody, Bingerville, Marcory, Koumassi ainsi que cinq villages de la sous-préfecture de Songon (Songon-Kassemblé, Songon-Dagbé, Songon-Té, Songon-Agban, Songon Mbraté). Les bénéficiaires directs et indirects du projet sont estimés à 3,5 millions d’habitants, dont 850 000 de façon directe. Les autres communes du District autonome d’Abidjan bénéficieront aussi des activités transversales et autres activités, dans la mesure du possible, au cours de la mise en œuvre du projet.