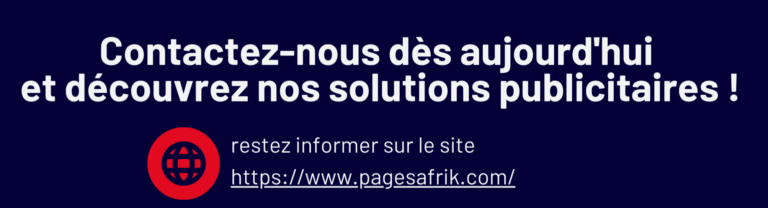Des perspectives mitigées pour la production de blé en Afrique du Nord

Les prévisions pour 2025 à l’échelle mondiale restent globalement inchangées La production mondiale de blé en 2025 devrait s’élever à 795 millions de tonnes, ce qui correspond à la production de l’année précédente, selon les dernières prévisions de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO). En mai, « les prévisions restent globalement inchangées par rapport au mois précédent, seuls des ajustements mineurs ayant été apportés pour tenir compte de facteurs météorologiques », a estimé l’agence onusienne dans son nouveau Bulletin sur l’offre et la demande de céréales. Selon les prévisions de la FAO, les perspectives sont mitigées en Afrique du Nord. D’après le document publié en début de ce mois, « le Maroc connaît une récolte inférieure à la moyenne, l’Algérie prévoit une récolte de blé proche de la moyenne, et l’Egypte (où l’irrigation est très utilisée) devrait enregistrer une production moyenne ou bien supérieure à la moyenne ». Il est à noter que la production totale de maïs en Afrique du Sud connaît une légère révision à la hausse en mai. L’institution l’impute à la « constance des conditions météorologiques favorables depuis le début de l’année ». Elle prévoit ainsi « un relèvement de la récolte en 2025 après la production de 2024 qui avait été réduite par le temps sec ». Le Maroc connaît une récolte inférieure à la moyenne, selon la FAO Il ressort dudit rapport que les prévisions de production de blé dans l’Union européenne ont été légèrement revues à la hausse ce mois-ci, suite à l’amélioration des conditions météorologiques dans les pays du Sud qui ont soutenu les prévisions de rendement global. Après le creux observé au terme de l’année écoulée, l’organisation internationale s’attend ainsi à un fort rebond de la production en 2025. Elle prévient toutefois que la sécheresse, qui touche les régions septentrionales fait peser un léger risque de dégradation des rendements. La FAO revoit également à la hausse ses prévisions de production concernant le Royaume-Uni, la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord qui se rapproche de la moyenne quinquennale, constatant cependant que « les températures anormalement chaudes du mois d’avril ont soulevé quelques inquiétudes sur les rendements potentiels ». A cause des conditions météorologiques défavorables et de la réduction des superficies, les prévisions concernant la Fédération de Russie restent identiques. Quand bien même les perspectives concernant le blé tablent toujours sur une production inférieure à la moyenne, du fait des effets du conflit, les précipitations du mois d’avril ont contribué à améliorer les conditions de culture dans certaines régions d’Ukraine, fait remarquer la FAO. De l’avis de l’agence, les perspectives de production en Amérique du Nord restent proches de celle de l’année dernière. «Aux Etats-Unis d’Amérique, les craintes de sécheresse persistent, ce qui devrait maintenir la production totale de blé à un niveau légèrement inférieur à celui de 2024», estime-t-elle. En dépit du fait que le temps chaud et sec observé en Inde a entraîné une révision à la baisse des prévisions de production nationales, l’institution «s’attend toujours à ce que 2025 soit l’année d’une récolte de blé record en Asie et revoit légèrement à la hausse les prévisions de production du Pakistan. En mai, les prévisions de production de blé en République islamique d’Iran et en Turquie restent inférieures à la moyenne, annonce la FAO. Si les prévisions de production dans l’hémisphère Sud sont légèrement revues à la hausse, l’institution s’attend en revanche à ce que la production de blé recule par rapport à 2024 en Australie, bien qu’elle reste supérieure à 30 millions de tonnes. Alain Bouithy
DEPF: Perspectives de reprise économique graduelle dans la zone Euro

L’économie de la zone euro a enregistré une reprise modérée de 0,7% en 2024 après 0,4% en 2023, malgré une contraction persistante en Allemagne (-0,2% après -0,3%), rapporte la Direction des études et des prévisions financières (DEPF) soulignant une résilience de la France (1,1% après 1,1%) et de l’Italie (0,7% après 0,7%) et à une forte expansion de l’Espagne (3,2% après 2,7%). La zone euro devrait poursuivre sa reprise graduelle, avec une hausse du PIB de 1,0% en 2025 et 1,2% en 2026, indique ce département relevant du ministère marocain de l’Economie et des Finances citant l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Toutefois, la croissance reste inégale selon les pays et les secteurs d’activité, fait-il savoir dans sa Note de conjoncture du mars 2025 (N°337). L’économie allemande devrait enregistrer une reprise modeste en 2025 (0,4%) qui devrait se renforcer en 2026 (1,1%), portée par une hausse des dépenses publiques1. La croissance française devrait se modérer cette année (0,8%), sous l’effet de l’ajustement budgétaire et de la détérioration du marché du travail, avant de se redresser l’année prochaine (1%). En Italie, le rythme de croissance devrait rester stable en 2025 (0,7%), avant de s’améliorer en 2026 (0,9%). En Espagne, la croissance continuerait de surperformer les pairs (2,3% en 2025 et 2,1% en 2026), malgré son ralentissement. La reprise dans la zone euro repose principalement sur le secteur des services, tandis que l’industrie manufacturière reste en récession. La consommation des ménages bénéficie d’un marché de l’emploi solide et d’une amélioration du pouvoir d’achat grâce à la baisse de l’inflation et à la progression des salaires. L’investissement reprend, soutenu par des taux d’intérêt en baisse et des coûts énergétiques modérés. Cependant, les perspectives demeurent fragiles face aux risques géopolitiques et protectionnistes, avec notamment la menace de tarifs douaniers américains. En outre, la zone euro reste confrontée à des défis structurels : faibles gains de productivité, pénuries de main-d’œuvre, transition énergétique coûteuse et sous-investissement, compromettant sa compétitivité. Au T4 2024, l’économie de la zone euro a affiché une croissance modérée (0,2% après 0,4% au T3), avec un faible gain de l’emploi. Parmi les grandes économies de la zone, l’Allemagne (-0,2%) et la France (-0,1%) se sont contractées, l’Italie a enregistré une croissance modeste (0,1), tandis que l’Espagne (0,8%) a poursuivi sa forte expansion. En glissement annuel, le PIB de la zone euro a rebondi de 1,2% (après +1% au T3). Les données à haute fréquence montrent des évolutions mitigées au sein de la zone euro début 2025. L’indice PMI composite (50,2 en février après 50,2 en janvier) signale une faible croissance du secteur privé. Les services restent en expansion (50,6 après 51,3), mais à un rythme ralenti, tandis que l’activité manufacturière demeure en contraction (47,6 après 46,6). Parmi les grands économies, l’Allemagne affiche une croissance modérée (50,4 après 50,5), l’Italie marque une nette reprise (51,9 après 49,7), l’Espagne maintient une forte expansion (55,1 après 54,0), tandis que la France enregistre un fort repli (45,1 après 47,6). La production industrielle de la zone euro a rebondi en janvier (0,8% après -0,4% en décembre), tirée par l’Allemagne (2,1% après -1,9%) et l’Italie (2,9% après -2,5%), malgré un repli en France (-0,6% après -0,5%) et en Espagne (-1% après 1%). Sur un an, elle s’est stabilisée, mettant fin à 20 mois de contraction. En revanche, les ventes de détail dans la zone euro ont enregistré un repli en janvier (-0,3%), après deux mois consécutifs de stagnation. Par pays, les ventes ont diminué en Italie (-0,4%) et en France (-0,1%), mais progressé en Allemagne (+0,1%). Néanmoins, l’indice de sentiment économique (ESI) de la zone euro a confirmé son amélioration en février (+1,0 point à 96,3), avec notamment une hausse de la confiance des consommateurs (+0,6 point). Le marché de l’emploi reste solide. Le taux de chômage dans la zone euro est resté stable pour le 3ème mois d’affilée à 6,2% en janvier, son plus bas historique. Toutefois, des différences significatives sont observées entre les États membres. Le chômage a nettement diminué en Espagne (-2,9 points sur un an pour se situer à 10,4% en janvier) et en Italie (-2,3 à 6,3%), resté inchangé en France (à 7,3%), mais a rebondi en Allemagne (+0,3 à 3,5%). La pénurie de main-d’œuvre qualifiée reste un défi majeur pour les entreprises. L’inflation globale de la zone euro s’est atténuée en février (à 2,3% après un pic de 2,5% en janvier). La hausse des prix a décéléré pour les services (3,7% après 3,9%) et l’énergie (0,2% après 1,9%). L’inflation sous-jacente, qui exclut l’énergie et l’alimentation, a aussi ralenti (à 2,6% après 2,7%), marquant son plus bas niveau depuis janvier 2022. Selon la BCE, l’inflation globale devrait légèrement ralentir en 2025 (pour se situer à 2,3%), puis baisser pour se rapprocher de la cible de 2% en 2026 (1,9%). De son côté, l’inflation sous-jacente devrait se modérer, passant à 2,2% en 2025 et 2,0% en 2026. Dans ce contexte désinflationniste, la BCE continue d’assouplir sa politique monétaire pour stimuler une reprise économique encore atone. Début mars, elle a réduit ses taux directeurs de 25 points de base (pb), portant le cumul des baisses à 185 pb depuis juin 2024. Les taux de la facilité de dépôt, des opérations principales de refinancement et de la facilité de prêt marginal ont ainsi été ramenés à respectivement 2,50%, 2,65% et 2,90%. La BCE a affirmé que les taux sont devenus nettement moins restrictifs, laissant entrevoir d’autres baisses possibles. Toutefois, le rythme et l’ampleur des réductions des taux dépendront de l’évolution des perspectives économiques et de l’inflation. La BCE table désormais sur une croissance du PIB de seulement 0,9% en 2025 et 1,2% en 2026 (contre 1,1% et 1,4% prévu en décembre). Elle prévient que les craintes d’une guerre commerciale nuisent à l’économie. Sur le marché des changes, l’euro s’échangeait à 1,08 dollar le 24 mars, en hausse de 4% depuis le début du mois et de 6,1% depuis son creux de 26 mois atteint le 13 janvier. L’euro est soutenu par les mesures de
Nouveau rapport de la Banque mondiale : croissance économique en Tunisie et perspectives pour son système fiscal

L’économie tunisienne a enregistré une croissance de 0,6 % au premier semestre 2024, marquant une légère amélioration par rapport à 2023, selon la dernière édition du rapport sur la conjoncture économique de la Banque mondiale. Des signes encourageants apparaissent, notamment une amélioration du solde extérieur et une réduction de l’inflation. Parallèlement, si le secteur agricole montre des signes de reprise, d’autres secteurs clés, dont le pétrole et le gaz, l’habillement et la construction, continuent rencontrer des obstacles. Le rapport intitulé « Équité et efficience du système fiscal tunisien » prévoit une croissance de 1,2 % pour 2024. Cette performance intervient dans un contexte de ralentissement de la croissance économique au cours de la dernière décennie, marqué par des taux d’investissement et d’épargne modérés. Le rapport insiste sur la nécessité d’augmenter les investissements pour soutenir la croissance et renforcer la concurrence. Les énergies renouvelables font figure de secteur dynamique où les investissements et la concurrence progressent, avec la mise en œuvre d’un ambitieux programme tunisien prévoyant la construction de 500 mégawatts de capacité via des projets solaires dans les régions de Kairouan, Sidi Bouzid et Tozeur. De plus, le gouvernement prévoit 1.700 mégawatts supplémentaires d’ici 2026, visant à porter la part des énergies renouvelables à 17 % du mix électrique et ainsi économiser 1 million de tonnes d’équivalent pétrole en importations de gaz, soit environ 30 % des importations totales de gaz en 2023. La Tunisie est aussi parvenue à contenir son déficit courant, principalement grâce à une amélioration des termes de l’échange, dont la baisse des coûts d’importation d’énergie et la hausse des prix à l’exportation de l’huile d’olive, en plus du rebond du secteur touristique. Le déficit commercial a baissé de 3,4 % sur les neuf premiers mois de 2024 par rapport à l’année précédente, représentant désormais 7,8 % du PIB, contre 8,8 % en 2023. L’inflation est tombée à 6,7 % en septembre 2024, son niveau le plus bas depuis janvier 2022, tandis que l’inflation alimentaire reste stable à 9,2 %. La Tunisie s’oriente de plus en plus vers des sources de financement internes, la dette intérieure étant passée de 29,7 % de la dette publique totale en 2019 à 51,7 % en août 2024. Cette tendance oriente une part croissante des financements des banques vers les besoins du gouvernement et les éloigne du reste de l’économie. Elle présente également des défis pour la monnaie et la stabilité des prix. La seconde partie du rapport examine le système fiscal tunisien, soulignant l’importance d’un meilleur équilibre entre la fiscalité sur le travail et celle sur le capital pour promouvoir une approche plus équitable. Actuellement, la charge fiscale sur le travail, y compris les importantes cotisations sociales, même pour les personnes à faible revenu, peut encourager l’informalité, freiner l’embauche et limiter les salaires. Le rapport recommande aussi davantage de transparence au sein du système fiscal pour renforcer l’équité et la responsabilité. L’instauration d’une taxe foncière annuelle et l’augmentation des taxes sur les carburants en 2023 ont constitué des mesures positives, et un rééquilibrage de la structure fiscale et un renforcement de la taxe carbone contribueraient à un cadre économique plus stable et durable. « Malgré des défis persistants, l’économie tunisienne continue de faire preuve de résilience, et de nouvelles opportunités se présentent, souligne Alexandre Arrobbio, responsable des opérations de la Banque mondiale pour la Tunisie. La Banque mondiale reste déterminée à soutenir la Tunisie à relever les défis soulignés dans le rapport, en particulier pour soutenir la croissance et le développement du secteur privé. » BM
La baisse des cours mondiaux des produits de base se tasse, compromettant les perspectives de réduction de l’inflation

Alors que les cours mondiaux des produits de base se stabilisent après la forte chute qui avait été enregistrée en 2023 et qui a joué un rôle clé dans le recul de l’inflation globale, les banques centrales pourraient avoir plus de mal à baisser rapidement leurs taux directeurs. Tel est le message principal du dernier rapport Commodity Markets Outlook de la Banque mondiale, qui souligne aussi la menace que fait peser un embrasement du conflit au Moyen-Orient sur la poursuite de la tendance désinflationniste observée au cours des deux dernières années. Entre la mi-2022 et la mi-2023, les cours mondiaux des produits de base avaient en effet chuté de près de 40 %, cette décrue des prix contribuant fortement à la réduction d’environ 2 points de pourcentage de l’inflation mondiale entre 2022 et 2023. En revanche, depuis le deuxième semestre de l’année dernière, l’indice des prix des produits de base de la Banque mondiale est resté globalement inchangé. Sans une recrudescence des tensions géopolitiques, les prévisions de la Banque tablent sur une baisse de 3 % des prix mondiaux des produits de base en 2024 et de 4 % en 2025. Ces baisses ne seront guère suffisantes pour juguler une inflation qui, dans la plupart des pays, reste supérieure aux cibles des banques centrales, les prix des produits de base se maintenant à un niveau environ 38 % plus élevé que celui enregistré en moyenne au cours des cinq années précédant la pandémie de COVID-19. « La bataille de l’inflation n’est pas encore gagnée, explique Indermit Gill, économiste en chef et premier vice-président du Groupe de la Banque mondiale. L’un des principaux moteurs de la désinflation, à savoir la chute des cours des produits de base, a atteint ses limites. Cela signifie que les taux d’intérêt pourraient rester plus élevés que prévu cette année et l’année prochaine. Le monde se trouve dans une situation de vulnérabilité : un choc énergétique majeur pourrait saper une grande partie des progrès réalisés ces deux dernières années dans la réduction de l’inflation. » Les fortes tensions géopolitiques des deux dernières années ont favorisé la tenue des prix du pétrole et d’un grand nombre d’autres matières premières, alors même que la croissance mondiale a ralenti. Dans le cas du pétrole Brent, par exemple, les prix ont grimpé à 91 dollars le baril au début du mois d’avril, soit près de 34 dollars de plus que la moyenne sur la période 2015-2019. Et, selon les prévisions de la Banque, ils devraient s’établir en moyenne à 84 dollars en 2024, puis à 79 dollars l’année suivante, en supposant que le conflit n’entraîne pas de perturbations de l’offre de pétrole. En revanche, en cas d’intensification du conflit au Moyen-Orient, ces perturbations pourraient raviver l’inflation mondiale. Le prix moyen du Brent pourrait ainsi remonter cette année à 92 dollars le baril en cas de perturbation modérée de l’offre de pétrole, voire dépasser les 100 dollars en cas de perturbation plus grave, ce qui conduirait à une hausse de près d’un point de pourcentage de l’inflation mondiale en 2024. « On voit émerger une divergence frappante entre croissance et prix des produits de base : malgré une croissance mondiale relativement plus faible, les prix des produits de base resteront très probablement plus élevés en 2024-25 qu’au cours des cinq années précédant la pandémie de COVID-19, souligne Ayhan Kose, économiste en chef adjoint de la Banque mondiale et directeur de la cellule Perspectives. Cette divergence s’explique en grande partie par des tensions géopolitiques exacerbées qui tirent vers le haut les prix des principales matières premières et contribuent à alimenter des risques de fortes fluctuations des cours. Les banques centrales doivent rester vigilantes quant aux répercussions inflationnistes induites par de possibles flambées des prix des produits de base dans un contexte de tensions géopolitiques élevées. » Le prix moyen de l’or, placement de choix pour les investisseurs en quête d’une « valeur refuge », devrait atteindre un niveau record en 2024, avant de se tasser légèrement l’année prochaine. L’or est un actif qui a la particularité de souvent se renchérir pendant les périodes d’incertitude géopolitique ou politique, comme les conflits. La forte demande émanant de plusieurs banques centrales de pays en développement, ainsi que la montée des difficultés géopolitiques, devraient soutenir les prix de l’or tout au long de l’année 2024. Une escalade du conflit au Moyen-Orient pourrait également faire grimper les prix du gaz naturel, des engrais et des denrées alimentaires, note le rapport. La région joue en effet un rôle crucial dans l’approvisionnement en gaz naturel : 20 % du commerce mondial de gaz naturel liquéfié (GNL) transite par le détroit d’Ormuz. Dans l’hypothèse d’une interruption de l’approvisionnement en GNL, les prix des engrais augmenteraient considérablement, ce qui entraînerait probablement une hausse des prix alimentaires. Toutefois, le scénario de référence de la Banque mondiale table plutôt sur un léger fléchissement des prix des denrées pour 2024 (-6 %) et 2025 (-4 %). Quant aux prix des engrais, ils devraient baisser de 22 % en 2024 et 6 % en 2025. L’accélération des investissements dans les technologies vertes alimente une hausse des prix des métaux indispensables à la transition énergétique. Les cours du cuivre, métal nécessaire au développement des infrastructures électriques et à la production de véhicules électriques, ont atteint en avril leur plus haut niveau depuis deux ans. Ils devraient baisser de 5 % en 2024, avant de se stabiliser en 2025. Les prix de l’aluminium devraient progresser de 2 % en 2024 et de 4 % en 2025, tirés par la production de véhicules électriques, de panneaux solaires et d’autres infrastructures d’énergie renouvelable. Dans un dossier spécial, le rapport évalue cinq méthodes communément utilisées pour prévoir les prix de trois produits de base essentiels : le pétrole brut, le cuivre et l’aluminium. Il en ressort que chacune d’entre elles présente un certain nombre de faiblesses, mais aussi des points forts importants. Par conséquent, cette analyse préconise de recourir à diverses approches analytiques pour améliorer la qualité des prévisions, tout en faisant preuve de jugement.
Taylan Süer, Directeur général de PMI Maghreb, livre ses perspectives pour la région

En prenant en charge la destinée de la filiale de Philip Morris International dans la région du Maghreb, en tant que Directeur Général, M. Süer s’est engagé à accélérer la transformation de PMI pour concrétiser le plus rapidement possible «la vision d’un avenir sans fumée » au Maroc, Algérie, Tunisie et Libye. Les premiers mois de son mandat se sont traduits par le positionnement du Maghreb en tant que l’un des hubs les plus influents dans la zone Afrique et Moyen Orient. L’objectif est de consolider une partie importante des activités de la région au niveau de la filiale Marocaine, afin d’accélérer la commercialisation responsable d’alternatives sans combustion sans fumée et moins nocives, dans le but de remplacer les cigarettes dès que possible. Dans ce sens, M. Taylan Süer a déclaré que « le Maghreb est l’une des régions prioritaires et parmi les plus importantes pour la transformation de Philip Morris International vers un avenir sans fumée. Mon objectif pour les années à venir, est d’accélérer l’implémentation de notre vision au Maghreb et offrir aux fumeurs adultes qui autrement continueraient à fumer, des alternatives à risque réduit en comparaison à la cigarette ». Fort d’une expérience de près de 20 ans au sein de PMI, M. Süer a occupé plusieurs postes clés tels que Directeur Général au Liban, Directeur Général Duty Free pour le Moyen-Orient et l’Afrique, et Directeur Général en Bosnie Herzégovine. Concernant son parcours académique, M. Süer est titulaire d’un diplôme en économie de l’Université Sabanci en Turquie, d’un Executive MBA de l’Université Koç et d’un diplôme exécutif de l’Université de Stanford. Construire un avenir sans fumée Philip Morris International (PMI) est une société internationale de tabac de premier plan qui œuvre pour un avenir sans fumée et qui fait évoluer son portefeuille à long terme pour y inclure des produits en dehors du secteur du tabac et de la nicotine. Le portefeuille actuel de produits de l’entreprise se compose principalement de cigarettes et de produits sans fumée, y compris des produits de tabac chauffé, de vapotage et des produits à base de nicotine orale. Depuis 2008, PMI a investi plus de 10,5 milliards USD pour développer, étayer scientifiquement et commercialiser des produits sans fumée innovants, pour les adultes qui autrement continueraient à fumer, dans le but de mettre fin à la vente de cigarettes. Cela comprend la mise en place de capacités scientifiques de niveau mondiale, notamment dans les domaines de la toxicologie, des systèmes précliniques, de la recherche clinique et comportementale, ainsi que des études post-commercialisation. En novembre 2022, PMI a acquis Swedish Match – un leader dans le domaine de l’administration de nicotine par voie orale – créant ainsi un champion mondial des produits sans-fumée, mené par les marques IQOS et ZYN des deux entreprises. La Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a autorisé la commercialisation des versions des dispositifs et consommables IQOS Platform 1 de PMI et le snus General de Swedish Match en tant que produits du tabac à risque modifié (Modified Risk Tobacco Products – MRTP). Au 31 Mars 2023, les produits sans fumée de PMI étaient disponibles à la vente sur 80 marchés, et PMI estime qu’environ 25,8 millions d’adultes dans le monde sont déjà passés à IQOS. Les produits ont représenté environ 35% du chiffre d’affaires net total de PMI. Forte d’une base solide et d’une grande expertise dans les sciences de la vie, PMI a annoncé en février 2021 son ambition de se développer dans les domaines du bien-être et des soins de santé et par le biais de sa filiale Vectura Fertin Pharma, vise à améliorer la vie en offrant des expériences de santé harmonieuses.
DEPF: Les Etats-Unis affichent des perspectives de croissance solide

L’économie américaine a fortement progressé au quatrième trimestre 2021 (6,9% en rythme annualisé après 2,3 % au T3), selon une analyse de la Direction des études et des prévisions financières (DEPF) relevant du Ministère marocain de l’Economie et des Finances. La reconstitution des stocks a fortement contribué à la croissance (4,9 points), a-t-elle expliqué dans sa note de conjoncture du mois de février dernier. Pour l’ensemble de l’année 2021, « l’économie a progressé de 5,7%, le plus haut depuis 1984. La croissance devrait se poursuivre à un rythme modéré mais robuste en 2022 (4% selon le FMI) », a indiqué la DEPF soulignant que la demande intérieure est soutenue par la solide consommation des ménages et les mesures de relance budgétaire. Selon son analyse, les perspectives sont confrontées à une inflation persistante, une politique monétaire plus restrictive, des incertitudes sur la pandémie et des tensions géopolitiques (avec la Russie et la chine). Si la croissance devrait ralentir début 2022, freinée par la récente vague d’infections au variant Omicron, la DEPF a toutefois noté que les nouveaux cas Covid-19 se sont inscrits en fort repli, après avoir atteint un pic la mi-janvier. Il est à noter que la croissance de l’activité du secteur privé a ralenti en janvier, comme le montre l’indice PMI composite (51,1 après 57,0 en décembre). Selon la DEPF, « la décélération a concerné le secteur manufacturier (55,5 après 57,7) et, surtout, celui des services (51,2 après 57,6), perturbé par le variant Omicron. Néanmoins, les ventes de détail ont rebondi en janvier (+3,8% après -2,5% en décembre), les consommateurs ayant continué à dépenser malgré la flambée des cas de COVID-19 et la forte inflation ». Concernant le taux de chômage, il s’est établi à 4% en janvier après un creux de 3,9% en décembre, marquant une baisse de 2,4 points depuis un an. D’après les chiffres disponibles, « l’économie a créé 467 000 emplois nets en janvier contre 510 000 en décembre et une moyenne mensuelle de 555 000 en 2021. Les loisirs et l’hôtellerie ont mené les gains, malgré la vague d’omicron. L’emploi non agricole a augmenté de 19,1 millions depuis avril 2020, mais reste en baisse de 2,9 millions (ou 1,9%) par rapport à son niveau d’avant la pandémie en février 2020 ». Quant au taux d’inflation, il apparait qu’il « poursuit sa montée pour atteindre 7,5% en janvier, son plus haut niveau depuis 1982, amplifiée par une forte demande, des ruptures d’approvisionnement, une flambée des coûts de l’énergie et une pénurie de main-d’œuvre ». Tandis que l’inflation sous-jacente a rebondi à 6% en janvier. Notons que pour faire face aux pressions persistantes d’inflation, « la Fed a indiqué que son programme d’assouplissement quantitatif se terminera en mars et qu’elle envisage des hausses de taux d’intérêt peu de temps après », a fait savoir la DEPF. Martin Kam avec CP
Congo. Quelles trajectoire et perspectives après 100 jours du gouvernement Collinet Makosso ?

TRIBUNE. Nous voilà bientôt à cent jours, depuis que le Premier Ministre Anatole Collinet MAKOSSO nommé par décret n° 2021-300 du 12 mai 2021, mettait en place le 15 mai 2021 un gouvernement de 36 membres ayant comme mission essentielle d’exécuter les neuf axes stratégiques du projet de société défendu par le Président de la République Denis SASSOU NGUESSO, lors de la campagne présidentielle « Ensemble poursuivons la marche ». Ce projet de société qui caractérise la vision du chef de l’Etat de travailler pour un Congo en paix, pour une nation forte, respectée, moderne avec une croissance économique, inclusive et durable qui profite à tous les congolais, témoigne d’une réelle dynamique de conduire notre pays vers l’émergence tant attendue. Il ne s’agit pas ici pour l’essentiel d’apprécier les résultats obtenus en 100 jours. Il est plutôt question de « voir si la trajectoire empruntée est bonne, si l’équipe gouvernementale a une vision collective des objectifs à atteindre et si les promesses faites lors de la campagne intègrent l’agenda gouvernemental »… Depuis que ce gouvernement est en place, on voit bien que, les mentalités sont en train d’évoluer positivement en matière de gestion de la chose publique. Les écarts autres fois permis sont en train de disparaitre petit à petit et la confiance se profile au rendez-vous. Le Premier Ministre Anatole Collinet MAKOSSO à sa manière ne bouleverse pas, il a même gardé la majorité des conseillers de son prédécesseur, mais il imprime une dynamique qui confirme la volonté de changement déjà inscrite dans la composition du gouvernement. Il manifeste une volonté de changements, de rompre avec certaines pratiques, et n’est pas adepte de la verticalité dans ses prises de décision. Une attitude qui témoigne d’un changement de style à la tête de l’État. On voit bien que le Premier Ministre est déterminé à imposer des règles de bonne gouvernance et d’éthique, notamment dans le secteur toujours sensible de la gestion financière. La création du ministère du contrôle d’état chargé de la qualité du service public et de la lutte contre les antivaleurs confié à Jean rosaire IBARA est la preuve d’une volonté affichée de lutter contre certaines pratiques qui ont plombé notre pays dans la crise. Outre la pérennisation de la paix dans notre pays, malgré la situation difficile de nos finances publiques, le gouvernement s’est employé entre autres au titre du ministère des finances à : – renforcer des capacités des structures par la mise en place d’un plan de perfectionnement, de recyclage et de formation des personnels au ministère des finances ; – suspendre des comptes de prépaiement mise en place par les gouvernements précédents pour la compensation des engagements de l’Etat au moyen des droits et taxes de douanes ; – payer régulièrement les salaires des fonctionnaires ; – payer 2 mois des pensions de retraite ; – payer des indemnités de fin de carrière des fonctionnaires admis à faire valoir leurs droits à la retraite. En ce qui concerne la mobilisation des ressources extérieures, l’accent est en train d’être mis sur l’amélioration des capacités d’absorption de l’économie et le renforcement de la coopération au développement. Ainsi, le ministre de la coopération internationale et de la promotion du partenariat public-privé Denis Christel SASSOU NGUESSO est à la baguette pour donner une nouvelle orientation à notre coopération. Il s’est inscrit dans une dynamique de revitalisation de la coopération en rencontrant à plusieurs reprises les partenaires membres du Corps diplomatique accrédités dans notre pays et les différents partenaires financiers afin de définir, orienter et concrétiser leurs différentes politiques de coopération et d’intervention dans notre pays. Du côté du ministère de l’enseignement supérieur, le changement est palpable. La ministre Edith Delphine Emmanuelle ADOUKI, pour éviter les vols et les actes de vandalisme répétitifs à l’université Denis SASSOU NGUESSO de KINTELE ne s‘est pas privée de résilier le contrat avec la société privée qui assurait la sécurité du site. Une décision courageuse pas coutumière dans notre pays lorsqu’on connait les sommes mises en jeu dans ce genre des contrats. Il y a quelques semaines le campus TCHEULLIMA, a tout récemment été doté des nouveaux matelas pour améliorer les conditions des étudiants qui y vivent. Dans plusieurs départements ministériels, les changements sont visibles et les orientations sont suivies avec abnégation et une volonté de mieux faire. Il se dégage globalement un sentiment de satisfaction à l’égard du gouvernement dont le chef, ne ménage aucun effort pour instaurer un dialogue avec les partenaires sociaux, avec le monde économique comme l’atteste sa dernière rencontre avec les opérateurs économiques du KOUILOU. Certes, nous n’en sommes encore qu’au prélude d’activités qui engagent le gouvernement sur plusieurs années, après trois mois d’exercice, on le voit, ce gouvernement a la volonté, est enthousiaste, et s’est inscrit dans une dynamique positive pour la résolution des problèmes qui minent notre pays. Doit-on crier victoire ? Non. Nous ne sommes qu’au début d’un processus et le peuple attend encore les fruits de cette belle amorce. Ce qui est vrai c’est que nous n’avons aucune raison d’échouer. Pour la suite, tenant compte des attentes et des inquiétudes élevées, des impatiences de plus en plus fortes, la mobilisation doit être totale dans la bataille pour l’emploi et l’amélioration effective des conditions de vie des congolais, ceci en mettant un accent particulier sur le secteur des activités agricoles et de la formation qualifiante. En définitive, le cap des 100 jours franchi, les bases étant posées, le gouvernement Anatole Collinet MAKOSSO doit continuer à s’inscrire dans une perspective tournée vers un avenir radieux du peuple congolais, un avenir qui sera l’émanation de la poursuite de la dynamique enclenchée. Paris le 23 aout 2021 Henri Blaise NZONZA Président de la Nouvelle Dynamique pour le Congo
La lutte contre la pandémie de Covid 19 au Congo Brazzaville : constat, perspectives et déconfinement

TRIBUNE. En vue de freiner l’épidémie due au CORONAVIRUS, qui a officiellement causé le décès d’une dizaine de personnes et mis notre pays complètement à l’arrêt, les autorités gouvernementales ont pris une série de mesures. Ainsi le 31 mars 2020 a consacré le début de l’état d’urgence sanitaire ponctué par un couvre-feu sur toute l’étendue du territoire national. Depuis ce jour, certaines activités jugées non essentielles sont interdites. La circulation est soumise à l’obtention préalable d’une autorisation de sortie. Les frontières sont fermées, les bus privés et taxis sont interdits à la circulation. Quant aux marchés domaniaux, ils ne se tiennent que 3 jours par semaine. Les restaurants, les lieux de culte, les boutiques, les bars et les lieux de sport sont fermés. Après un mois de confinement, le président de la République Denis SASSOU NGUESSO a, dans un message à la nation, annoncé le 30 avril 2020, la prolongation du confinement à domicile pour deux semaines de plus. Par ailleurs la task Force mise en place par le gouvernement ne nous a pas encore dit si nous avons atteint le pic de la pandémie dans notre pays ou pas. Quarante jours après le déclenchement de cet état d’urgence sanitaire, quel bilan pouvons-nous faire ? Quelles leçons pouvons-nous tirer ? Et comment pouvons-nous aborder l’avenir avec plus de sérénité ? Aujourd’hui, force est de constater que le confinement est plus ou moins respecté selon les classes sociales et les quartiers. Dans les quartiers habités par des congolais qui ont des revenus au-dessus de la moyenne, le confinement est respecté. C’est le cas dans certains secteurs de Brazzaville comme : Le centre-ville, Batignolles, l’OCH de Bacongo et de Moungali. Cependant, dans les quartiers populaires, le confinement se fait en dents de scie. Déjà fortement affectés par les coupures d’électricité et d’eau courante, les habitants de ces quartiers voient leurs conditions de vie se dégrader depuis le début de la quarantaine. La plupart des habitants vivent d’emplois informels et en restant bloqués chez eux, ils n’ont plus aucuns revenus. Ils vivent au jour le jour et font des boulots souvent précaires, parfois sans contrat de travail pouvant leur assurer des revenus en cette période de confinement. Il n’échappe à personne que les effets combinés de la crise économiques et du confinement commencent à rendre la vie très dure et même pénible aux habitants de ces quartiers pauvres qui se retrouvent sans activités. Nous pensons que le temps est venu d’alléger le dispositif de la quarantaine pour permettre à la population de respirer tout en mettant quelques garde-fous. Nous pouvons donc mettre en place un plan de déconfinement progressif qui se fera en plusieurs étapes et dont l’amorce se fera dans la deuxième quinzaine du mois de mai. Il faut donc enclencher un assouplissement en prenant des mesures mieux adaptées à nos réalités. Outre l’obligation du port des masques, lors de tous déplacements, qui constitue une avancée significative dans la lutte contre cette pandémie, il est important que des mesures ci-après soient prises dans cette première phase : -Le maintien du couvre-feu. Cette mesure est essentielle car elle permet aux forces de l’ordre de faire appliquer certaines dispositions relatives aux mesures barrières édictées par les autorités du pays. Si le couvre-feu est levé, il y aura un relâchement. Les rencontres nocturnes de tout genre favorisant la propagation du virus ; -Pour ralentir la propagation du virus, il faudra traiter toutes les personnes contaminées par le COVID-19 et procéder à l’identification, au dépistage et au suivi de toutes les personnes avec lesquelles, elles étaient en contact ; -La réouverture des frontières aériennes (aéroports). Il faudra au préalable tester tous les passagers qui atterriront dans nos aéroports. Cette mesure implique aussi la mise en quarantaine et l’isolement de tous ces passagers entrant sur le territoire congolais ; -Ramener le nombre des jours de marchés domaniaux de 3 à 4 jours dans la semaine comme décidé précédemment, il y a peu, par le Maire de Brazzaville. Cette mesure permettra de réduire l’afflux massif que nous observons dans ces marchés ; -Autoriser la circulation des taxis et des bus, ceci pour permettre à la population de ne plus subir le calvaire qui le contraint à faire des kilomètres à pieds. Dans les quartiers périphériques beaucoup des personnes meurent par manque de moyens de transport pouvant leur permettre de se rendre en urgence dans les hôpitaux ; -La mise en place d’une circulation alternée des voitures personnelles, des Taxis et des Bus. Les voitures personnelles, taxis et bus qui ont des numéros impairs circuleront les : lundi, mercredi et vendredi. En revanche les voitures et bus ayant des numéros pairs circuleront les : mardi, jeudi et samedi. Aucune voiture, taxis ou bus ne devra circuler le dimanche sauf pour les cas d’extrême urgence ; -Limiter le nombre de personnes dans les voitures personnelles et taxis à 3, à 10 dans les minibus (type Hiace) et 15 dans les bus (type Coaster) ; -La réouverture de l’Université Marien-NGOUABI, des université privées ainsi que des classes pour les élèves de Terminale, Troisième et CM2. Il est impérieux d’éviter une année blanche dans nos universités tout comme il est de notre devoir de permettre aux élèves en classes d’examens d’aborder leurs évaluations dans des meilleurs dispositions ; -La réouverture des restaurants. Ceux-ci devront se limiter à la vente des plats à emporter ; -La réouverture des boutiques d’alimentation et des petits marchés de proximité afin de désengorger les marchés domaniaux bondés de monde et qui sont des lieux propices à la propagation du Covid-19 car le respect d’une distance d’un mètre ne peut y être observé ; -La reprise des activités pour les professions libérales : maçons, peintres, menuisiers, électriciens, mécaniciens, plombiers, jardiniers… Ainsi appliquées et respectées, ces mesures d’ordre social, sanitaire et économique, ajoutées au respect de certains gestes barrières tels que : se laver régulièrement les mains, tousser sous le coude et respecter la distance physique d’un mètre, pourront permettre à notre pays de faire face à cette