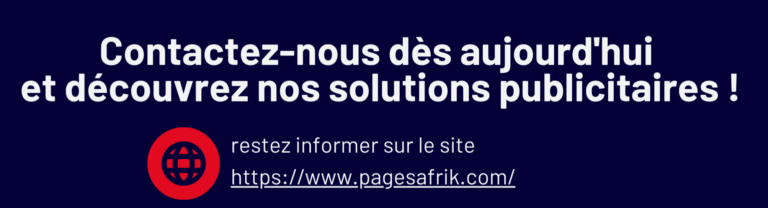Le fédéralisme communautaire : une régression de l’idée d’un État-nation camerounais

PARLONS-EN. Le monde s’unifie : les langues se généralisent, les peuples se mélangent sans se perdre. C’est l’évolution naturelle des sociétés : la planète devient de plus en plus un village. Mais au Cameroun, certains programmes politiques semblent vouloir nous maintenir dans des considérations ethniques et géolocalisées. La proposition du candidat Cabral Libii (le fédéralisme communautaire ) illustre parfaitement cette tendance : enfermer les Camerounais dans des sphères identitaires, tribales et sociologiques. Pourtant, nous devons travailler à reléguer les identités communautaires à l’intime pour faire rayonner une identité nationale commune. Ce fédéralisme propose un découpage territorial basé sur les communautés. Il semble oublier que les migrations internes ont profondément modifié le visage de chaque région : des communautés complètement différentes partagent aujourd’hui les mêmes espaces. Il oublie le métissage grandissant qui façonne une population camerounaise de plus en plus « homogène ». Un enfant peut être de père Bassa, de mère Bangangté, avoir une nièce Douala et un cousin Bulu. Où placer cette génération de mélange dans un découpage territorial strictement communautaire ? Les partisans de ce projet affirment qu’il vise à valoriser les identités ethniques. L’intention peut sembler noble, mais la méthode est problématique. Dans un Cameroun uni, il ne s’agit pas d’effacer nos identités, elles sont notre richesse. Il s’agit de les connaître, de les faire connaître, de les partager, de les ouvrir aux autres pour renforcer notre fraternité. C’est cette proximité culturelle qui, associée à notre identité nationale commune fera naître un Cameroun des cœurs, non pas la création de nouvelles frontières. Le fédéralisme communautaire prétend également mettre en valeur les compétences régionales. Mais cette approche pourrait au contraire alimenter frustrations et rivalités hégémoniques. Que se passera-t-il si une région, moins développée économiquement, devient la cible de stigmatisations ? Je suis pour un Cameroun fédéral, mais sur la base de critères géographiques et économiques, et non sur l’ethnicité. Je suis pour un Cameroun qui valorise les identités, mais pas au détriment d’une identité nationale qui fonde la nationalité et la cohésion sociale. Je suis pour un Cameroun qui met en avant les compétences, mais dans une logique nationale, au service du bien commun. Par Teddy Patou Journaliste et animateur radio
La Fondation ASAF Cameroun d’Eran Moas récompense les lauréats de son concours d’écriture

La Fondation ASAF Cameroun a célébré le talent et la créativité de jeunes écrivains lors de la cérémonie de remise des prix du concours national d’écriture, qui s’est tenue le 13 septembre à Douala. Lauréats, familles et passionnés de littérature se sont réunis pour mettre en lumière l’imagination des jeunes participants. Lancé début août par la Fondation ASAF Cameroun, créée par Eran Moas, le concours a rencontré un vif succès avec plus de 150 participants venant de tout le pays, représentant différentes classes sociales et régions, y compris le Nord et le NOSO, en plus des grandes villes et capitales. Fidèle à sa mission de placer l’éducation au cœur de ses actions, la fondation s’engage à renforcer l’accès à l’école et à promouvoir l’égalité filles-garçons. La scolarisation des filles au secondaire reste faible, avec seulement 43 % d’entre elles inscrites selon l’UNESCO. À travers ce concours, la fondation offre aux jeunes un véritable espace d’expression et de développement, ouvert à tous, sans distinction de milieu ou de région. Ambassadrice d’honneur du concours et lauréate du Prix Goncourt des Lycéens 2020, Djaili Amal Amadou a lu les textes des participants et récompensé les plus remarquables. Reconnue pour une écriture qui inspire et soutient les enfants issus de milieux défavorisés, elle anime depuis deux ans des ateliers d’écriture dans les bibliothèques de quartier, favorisant la créativité et l’expression personnelle. Lors de la cérémonie, elle a salué des textes riches de sensibilité et d’imaginaire.Afin d’assurer une représentativité équilibrée et de mettre en valeur la diversité des talents, les gagnants ont été répartis en trois catégories d’âge.8-10 ans : Amina Aïda Tikire (8 ans), Samuel Providence Akim (9 ans), Abigail Ngebi Tanwie (10 ans).11-13 ans : Gloriane Abigail Wabon Boh (13 ans), Mansour Hamadou (12 ans), Grâce Stéphanie Winidy Haman (13 ans).14-16 ans : Adora Tiangueu Emako (15 ans), Noëlla Grâce Delemouele (14 ans), Ashmen Paam (16 ans). Un prix spécial a également été décerné à Christelle Bime (15 ans) pour la qualité de son écrit.Les lauréats ont reçu des sacs, tablettes, fournitures scolaires et autres lots pratiques destinés à les accompagner dans leur réussite académique. Tous les participants, qu’ils aient pu être présents à la cérémonie ou non, recevront un cartable et un certificat de participation, valorisant leur créativité et leur engagement. « Avec ce concours, nous avons voulu montrer aux jeunes qu’écrire n’est pas seulement un exercice scolaire, mais aussi une façon de s’exprimer, de prendre confiance et de se projeter. C’est une fierté de voir leur enthousiasme. », a déclaré Eran Moas, fondateur de la fondation ASAF Cameroun. De son côté, Djaili Amal Amadou a rappelé que « L’écriture, c’est le pouvoir des mots. Elle permet de transformer, de libérer et d’inspirer. ». Au-delà du concours, la Fondation ASAF Cameroun poursuit son engagement en faveur de l’accès à la culture et de la promotion de la lecture. Elle appuie le travail des bibliothèques communautaires Djaili Amal Amadou en leur fournissant livres et manuels, permettant ainsi aux jeunes de continuer à créer, apprendre et rêver tout au long de l’année. Avec cette initiative, la fondation réaffirme sa conviction : chaque mot peut être une force de changement. En donnant la parole à la jeunesse, ASAF Cameroun entend créer un espace où les idées circulent, se confrontent et se renforcent, en incluant tous les jeunes du pays, quelles que soient leur région ou leur origine sociale. Ce concours n’est qu’une étape d’un engagement plus vaste : renforcer la confiance des jeunes dans leur capacité à écrire leur propre histoire, tout en leur offrant des outils concrets pour réussir. L’ambition est claire : faire de la lecture et de l’écriture des leviers de réussite scolaire, personnelle et citoyenne.L’édition 2026 est déjà en préparation, avec l’objectif de toucher encore davantage de jeunes à travers le Cameroun et d’élargir l’accès aux ateliers d’écriture dans les bibliothèques communautaires. À propos de la fondation ASAF CamerounFondée en 2016 par Eran Moas, la Fondation ASAF Cameroun est une organisation à but non lucratif engagée dans la promotion du développement social et humain au Cameroun. Elle œuvre notamment dans les domaines de l’éducation, de la santé et dans la protection de la faune.À travers ses programmes et partenariats, la Fondation ASAF Cameroun vise à renforcer les capacités locales, soutenir des initiatives durables et encourager l’innovation sociale. Elle place l’humain et la solidarité au cœur de toutes ses actions afin de contribuer à un avenir plus équitable et prospère pour tous.
Médias: l’Afrique dans la presse internationale (Revue de presse du 08 au 10 septembre)

Mercredi 10/09. Africanews : Le premier ministre sénégalais Ousmane Sonko annule sa toute première visite en France. Dans un communiqué, la primature évoque un empêchement lié à son agenda, précisant qu’Ousmane Sonko sera représenté lors de cet événement par un membre du gouvernement. Dans un contexte de redéfinition des relations entre la France et le Sénégal, cette annonce alimente les spéculations, certains observateurs y voyant un acte de rupture avec l’Hexagone. Sputnik : Selon un communiqué officiel de l’État-Major Général des Armées, une opération d’envergure a permis de démanteler une base terroriste majeure dans la région de Kayes. Grâce à une patrouille aérienne précise et une coordination sans faille, des dizaines de terroristes ont été neutralisés, leur repaire a été détruit. DW : En République démocratique du Congo, après une semaine de tensions, certaines activités ont repris, bien que timidement, dans la ville d’Uvira, après le départ supposé du général Olivier Gasita, commandant adjoint chargé des opérations et renseignements de la 33e région militaire, dans l’est de la RDC. Cet officier, issu de la communauté tutsi congolaise des banyamulenge, a été accusé, sans preuves, d’être un agent double au service de la rébellion de l’AFC-M23. Rfi : Au Gabon, à une semaine du début de la campagne électorale officielle mercredi 17 septembre, en vue des élections locales et législatives du 27 septembre, la Cour constitutionnelle s’est prononcée mercredi 10 septembre sur de nombreux recours déposés par des candidats écartés du processus par le ministère de l’Intérieur. Parmi les recalés, il y a l’ancien leader syndical Jean-Rémy Yama. RT en français : Le Zimbabwe a officiellement annoncé sa campagne pour intégrer le Conseil de sécurité des Nations unies en tant que membre non permanent pour le mandat 2027–2028. Cette candidature, qui sera soumise au vote de l’Assemblée générale de l’ONU en 2026, bénéficie déjà du soutien de plusieurs partenaires internationaux, dont la Russie, l’Inde, Cuba, ainsi que de la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC) et de l’Union africaine. Jeuneafrique : À quelques jours de la rentrée prévue le 15 septembre, les présidents de l’Assemblée nationale, Vital Kamerhe, et du Sénat, Jean-Michel Sama Lukonde, sont visés par des pétitions qui demandent leur destitution, ainsi que celle des membres de leur bureau. Africanews : L’Est de la République Démocratique du Congo est à nouveau frappé par une tragédie. Une vague de violence d’une ampleur terrifiante a déferlé sur la région du Nord-Kivu, laissant derrière elle un bilan humain désastreux. Mardi soir, les autorités ont annoncé la mort de 71 personnes sauvagement assassinées à Nyoto, alors qu’elles étaient réunies pour des funérailles la veille. Le lendemain, la terreur s’est abattue sur Beni, où 18 autres civils ont péri dans une attaque similaire. Mardi 9 septembre. Xinhua : Le gouvernement gabonais a adopté lundi en conseil des ministres un projet de décret portant création, attributions et organisation d’une commission interministérielle chargée du suivi des projets intégrés de transformation locale des minerais. Cette commission aura pour mission de coordonner et d’assurer le suivi des projets stratégiques liés au secteur minier. Rfi : Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais (RDPC), le parti du candidat président sortant du Cameroun Paul Biya, prépare son entrée en campagne pour l’élection présidentielle d’octobre. Une organisation massive structurée autour de plusieurs centaines de personnes, des hommes et des femmes issus de tous les milieux. RT en français : Le 9 septembre a eu lieu l’inauguration du Grand barrage de la Renaissance éthiopienne, une méga-centrale hydroélectrique construite sur le Nil Bleu, qui est devenue le plus grand barrage jamais construit sur le continent africain. Le projet, mis en service pour la première fois en 2022, a été officiellement inauguré après 14 ans de construction et un long différend avec l’Égypte et le Soudan voisins. Xinhua : Un total de 1.800 soldats de République centrafricaine (RCA) sont arrivés en Ouganda pour un entraînement militaire dans le cadre des efforts en cours pour renforcer les capacités de l’armée centrafricaine, a déclaré mardi un porte-parole de l’armée ougandaise. Les recrues seront soumises à un entraînement de base et à des exercices de collecte de renseignements pendant une période de neuf à douze mois. RT en français : Le Conseil constitutionnel ivoirien a annoncé le 8 septembre la validation de cinq candidatures sur soixante déposées pour l’élection présidentielle prévue le mois prochain. Parmi elles figure celle du président sortant Alassane Ouattara, 83 ans. DW : S’exprimant ce mardi devant le Conseil des droits de l’Homme des Nations unies, Bintou Keita, la cheffe de la Monusco, a déclaré que les violations des droits de l’Homme et du droit international humanitaire ont atteint un niveau qui sape les efforts entrepris pour rétablir la paix dans l’est de la RDC. Lundi 08/09. Sputnik : Les exportations d’or ont explosé en 2024 pour atteindre un record de 68,1 milliards de francs CFA, selon la Banque des États de l’Afrique centrale (BEAC). Cela représente une hausse de 183% par rapport à 2023. Au total, les exportations gabonaises se sont établies à 5.752,1 milliards de FCFA en 2024, soit une progression de 1,6% sur un an, d’après la BEAC. Adrien Thyg
Tensions à la frontière Centrafrique-Cameroun

À la frontière entre la Centrafrique et le Cameroun, les localités de Béloko et Cantonnier font face à une situation préoccupante. Malgré les engagements pris lors de la sixième commission mixte transfrontalière entre les deux pays, en juin 2024 à Bangui, les autorités locales dénoncent la poursuite de l’occupation d’une partie du territoire centrafricain par des forces camerounaises. Depuis plusieurs mois, des responsables communautaires et villageois alertent sur les tensions récurrentes nées de cette occupation. À Koundé-Sabal, un village situé dans la zone concernée, le chef Daniel Sodea témoigne d’un incident survenu récemment : « Les agents des eaux et forêts de Baboua étaient venus interdire l’exploitation de la forêt. Après leur départ, des militaires camerounais sont arrivés. Ils ont tiré à balles réelles sur la population. Cinq coups de feu. Plusieurs jeunes ont été emmenés de force à Bertoua, où ils ont été emprisonnés. L’un d’eux est gravement malade. Nous demandons que le gouvernement agisse », déclare-t-il. Des accords sans effet sur le terrain Du côté de Cantonnier, les autorités locales déplorent l’inefficacité des mesures décidées lors de la commission transfrontalière. Raphaël Soka, chef de canton, cite notamment le retrait par des militaires camerounais de trois mâts de drapeau récemment installés dans plusieurs villages frontaliers : « Quatre mâts avaient été érigés à Simon, Sabal, Koundé-Petel et Gassol. Trois ont été enlevés par les militaires camerounais. Grâce à l’intervention du commissaire de Béloko et du commandant de brigade de Koundé, un seul drapeau a pu être récupéré. Les deux autres sont toujours entre les mains des soldats camerounais », regrette-t-il. Face à ces intrusions, les forces de défense et de sécurité centrafricaines ont mis en place un poste de contrôle avancé à Petit Koundé-Sabal. Un dispositif qui vise à freiner l’expansion de l’occupation, mais qui reste symbolique, selon plusieurs habitants. Malgré les efforts diplomatiques de Bangui, la situation sur le terrain reste figée. Les populations locales appellent à une intervention plus ferme des autorités centrales pour résoudre ce conflit frontalier qui, selon elles, menace la cohésion communautaire et l’intégrité territoriale du pays. Pas encore de réaction officielle du côté du Cameroun. Radio Ndeke Luka
CAMEROUN : la photocratie

HAUT-ET-FORT. La photocratie, ou gouvernance par la photo, est un néologisme crée par les Camerounais pour décrire l’invisibilité de leur président. Complètement effacé de la vie publique, Paul Biya (bientôt centenaire) se montre rarement. Chaque apparition devient un événement célébré par ses partisans. Depuis janvier, il n’a été vu que trois fois. Enfin… deux fois et demi pour être précis. Lors de la fête de l’unité, il fut brièvement aperçu, filmé de loin, comme pour cacher une sénilité pourtant évidente. Paul Biya a toujours été distant du peuple camerounais, non pas seulement à cause de son âge, mais sans doute par manque d’amour. En quarante-trois ans, il n’a jamais visité toutes les dix régions du pays. Peut-être refuse-t-il d’exposer ses yeux et sa conscience à la misère hideuse qu’il a contribué à créer ? En revanche, mon président adore la Suisse. Jusqu’à récemment, il passait les trois quarts de l’année à l’hôtel Intercontinental de Genève, dont il a finalement été chassé par des activistes camerounais. Il aime aussi la France, où il se vante d’être le “meilleur élève”. Là-bas, il rend compte, pendant que son peuple attend en vain des comptes. Le mépris de Paul Biya est tel qu’il fait recevoir les chefs traditionnels par de simples supplétifs du palais. Mais il trouve encore la force de rencontrer l’ambassadeur de France en fin de mission au Cameroun. Une rencontre mise en scène, filmée à bonne distance, pour éviter de zoomer sur un visage marqué par les outrages du temps. Mon président semble dégoûté de ses citoyens. On dirait que nous le répugnons. Même dans les moments de deuil national, il reste absent. En 2020, lors du massacre de Ngarbuh, où une trentaine de civils dont des femmes enceintes et des enfants furent exécutés, le Cameroun attendait son président aux côtés des familles. Il s’est contenté d’un communiqué tardif et de quelques billets de banque. Il fit de même lors de la catastrophe de Dschang, qui fit vingt morts. Son mépris n’épargne personne, pas même la presse. En plus de quatre décennies, on peut compter sur les doigts d’une main le nombre d’interviews accordées aux médias locaux. Inutile de comparer avec les médias français. La distance entre Paul Biya et le peuple qu’il gouverne est abyssale, presque divine, disent certains de ses partisans. Pour eux, il est Dieu, et ils sont ses créatures. Jacques Fame Ndongo, ministre de l’Enseignement supérieur, l’a même affirmé en mondovision. Plus absurde encore : une thèse de doctorat sur le silence de Paul Biya a été validée dans une université camerounaise. Pas étonnant que nos institutions académiques soient reléguées en bas du classement mondial. En vérité, l’échec de Paul Biya n’est pas seulement celui de l’incompétence et de la cupidité. C’est surtout celui d’un homme qui n’a jamais aimé le peuple camerounais. Teddy Patou Journaliste et animateur radio
Cameroun. Je suis Bamiléké et fier de l’être

HAUT-ET-FORT. Loin d’être un repli identitaire, cette affirmation est un rappel de mes origines. Un rappel essentiel, surtout en ces temps qui courent. Oui, il y a un problème Bamiléké au Cameroun. Une fixation malsaine pèse sur ce peuple des hautes montagnes de l’Ouest. Une obsession héritée de la colonisation. On se souvient tous de cette phrase tristement célèbre de Jean-Marie Lamberton, officier français des années 60, qui qualifiait les Bamiléké de « caillou dans la chaussure du Cameroun ». Cette bamiphobie a été reprise et entretenue par le régime néocolonialiste d’Ahidjo, puis par celui de Paul Biya. Elle n’a pas seulement été un outil politique : elle est devenue une construction sociologique et culturelle. Le Bamiléké a été décrit comme un envahisseur, un roublard. Dans le Cameroun où nous avons grandi, certains allaient jusqu’à parodier une chanson en la transformant en : « si tu es Bami, c’est que Dieu t’a maudit ». Les insultes et assimilations animales ont suivi : « le porc », « le Bosniaque ». Ceci dans un pays qui prétend pourtant lutter contre le tribalisme. Cette bamiphobie se fait encore plus violente en politique. Ils aiment les Bamiléké bouffons (Jean de Dieu Momo), malléables, obéissants, exactement comme le colon aimait son « nègre de maison ». Mais le Bamiléké intelligent, influent, cohérent, objectif devient un obstacle. C’est ce que subit le professeur Maurice Kamto. On ne lui reproche pas son programme ni ses idées, mais simplement d’être Bamiléké. Dans ce pays, un ressortissant du Nord peut soutenir Bello ou Tchirouma sans être traité de tribaliste. Un Bassa peut appuyer Cabral Libii sans être accusé de communautarisme. Mais qu’un Bamiléké soutienne Kamto, et immédiatement il est stigmatisé. Oui, il y a un problème Bamiléké au Cameroun. Certains rétorquent en citant quelques Bamiléké présents au gouvernement. Mais Juvénal Habyarimana aussi avait quelques Tutsis dans son gouvernement : cela n’a pas empêché le génocide. Pourquoi cette bamiphobie s’est-elle exacerbée aujourd’hui ? Parce qu’une nouvelle génération de Bamiléké a émergé : fière, le torse bombé, les épaules droites et le regard ferme. Une génération qui a réussi à se débarrasser d’un complexe longtemps entretenu. Elle ose en politique, elle excelle dans les domaines les plus pointus. Elle a conscience de ses forces et de sa contribution à l’histoire du Cameroun indépendant, une contribution souvent payée au prix du sang de ses aïeux. Cette affirmation de soi scandalise les architectes de la bamiphobie. Elle les rend violents, au point de crucifier tout un pays simplement pour atteindre le Bamiléké. Nous devons continuer d’éduquer nos enfants à l’estime de soi, à l’amour de soi dans le respect des autres, à la justice et à l’équité. Nous devons les ancrer dans leur culture et leur identité, tout en leur rappelant qu’ils appartiennent à une nation diverse et hétérogène. Cette bamiphobie disparaîtra le jour où ceux qui l’entretiennent comprendront qu’ils n’ont pas d’autre choix que de faire avec nous. Par Teddy Patou Journaliste et animateur radio
Élection présidentielle au Cameroun : Quand l’objection de conscience rencontre la dissonance cognitive

TRIBUNE. Des millions de Camerounais vivent dans cet inconfort à la veille du scrutin controversé du 12 octobre prochain. Partagés entre le boycott, par respect pour les valeurs de justice, d’équité et d’égalité, et l’obligation d’y aller pour espérer un miracle du changement par les urnes. Cette lutte interne que beaucoup d’entre nous traversent révèle au moins deux choses : • La profonde déception, cette blessure intime toujours ouverte après l’éviction du professeur Maurice Kamto dans ce qui demeure, pour beaucoup, une conspiration flagrante. • L’intensité et l’enracinement de notre engagement pour le changement dans notre pays. Nous sommes face au choix entre l’égoïsme et l’objectivité. Refuser de voter pourrait, sans doute, satisfaire notre ego et notre principe. Pourtant, cette décision ne changera rien à la situation du Cameroun ; au contraire, elle servira d’alibi pour justifier l’hypothétique victoire d’un régime depuis longtemps habitué à la fraude et à la mascarade. Par contre, choisir d’aller aux urnes renforce le sens de notre lutte. L’enjeu est trop énorme pour nous offrir le luxe, à ce stade, d’être de simples spectateurs. Nous devons y aller, pour accomplir jusqu’au bout notre engagement en faveur du changement. Les questions majeures sont désormais de savoir : comment y aller ? Par quelle stratégie ? Sans doute à travers le jeu des alliances. Mais avec qui, et comment ? Autant d’interrogations encore en suspens, mais qui constituent désormais, à mes yeux, l’axe primordial de notre réflexion. Par Teddy Patou Journaliste et animateur radio
Cameroun : le théâtre des bouffons politiques

HAUT-ET-FORT. Le syndrome de Stockholm. Pour l’expliquer, inutile d’ouvrir un manuel de psychologie. Racontez seulement l’histoire de Célestin Djamen : tout y est. En 2018, il brandissait fièrement son titre de responsable des droits de l’homme au MRC, principal parti d’opposition. Aux lendemains d’une élection volée, son parti criait au hold-up électoral. Les Camerounais descendaient dans la rue, pacifiquement, pour réclamer la vérité des urnes. Le régime, fidèle à sa tradition répressive, sortit les armes. Premier rassemblement, première balle. Djamen s’écroule, le pied transpercé, traîné devant un tribunal militaire, jeté en prison. Un martyr, croyait-on. Mais à sa sortie, tout s’effondre. Le MRC boycotte les législatives de 2020 : adieu les rêves de strapontins. Djamen se voyait député, maire, notable. Le réveil fut brutal. La frustration se transforma en rancune, la rancune en trahison. Il claque la porte, fonde son propre parti, réduit à une cellule familiale : lui et son cousin. Puis, miracle ! L’ancien pourfendeur du régime découvre soudainement les charmes de Paul Biya. Son discours change : du fouet au baiser, du poing levé à la génuflexion. Hier, il accusait. Aujourd’hui, il rampe. Hier, il criait « hold-up électoral ! ». Aujourd’hui, il jure fidélité au bourreau qui a failli l’amputer. Et voilà Djamen, fraîchement enrôlé dans le fameux G20, ce club de micro-partis ventriloques, conglomérat d’aplaventristes, satellites de la mangeoire. Le plus grotesque ? Dans une interview, il ose déclarer que Paul Biya, 93 ans, fantôme épuisé par l’âge, serait le candidat idéal pour conduire le Cameroun. Le ridicule en costume trois-pièces. Mais Djamen n’est pas seul dans ce cirque. Dans toutes les dictatures, la récompense n’est pas le mérite, mais la servilité. Jean de Dieu Momo en est l’illustration : ex-opposant enflammé, devenu griot officiel. Et que dire du ministre de l’Enseignement supérieur, qui s’est présenté comme « la créature de Paul Biya » ? Une bassesse innommable pour un homme qui prétend encore penser. Ces hommes ravaleront leurs vomissures pour un strapontin. Ils sacrifieront leur honneur sur l’autel d’une nomination. Leur dignité vaut moins qu’une chaise bancale dans un gouvernement fantôme. Voilà le drame du Cameroun : une élite qui trahit pour manger, une classe politique qui vend ses convictions au rabais. Or la politique devrait être le domaine des valeurs, pas celui du ventre. Nous devons réapprendre, coûte que coûte, que la dignité et l’honneur surpassent mille fois tous les biens matériels. Sans cela, nous resterons un peuple enchaîné aux caprices d’un vieillard et aux trahisons de ses bouffons. Par Teddy Patou Journaliste et animateur radio