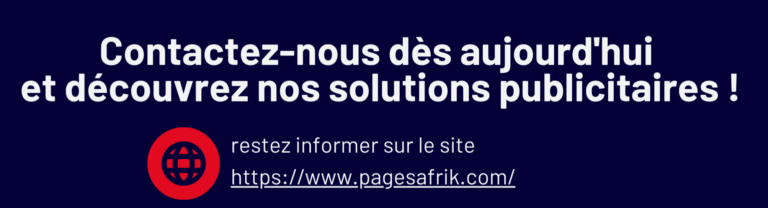Bluemind Foundation : Le FID renouvelle son soutien à « Heal by Hair » pour améliorer la santé mentale des femmes en Afrique

La Bluemind Foundation annonce un soutien renouvelé du Fonds d’innovation pour le développement (FID) pour son programme innovant « Heal by Hair ». Cette initiative unique transforme les salons de coiffure en espaces de soutien psychologique et de bien-être mental pour les femmes à travers l’Afrique. En octobre 2025, Lomé (Togo) accueille la 5ᵉ édition de ce programme pionnier : plus de 400 coiffeuses, formées à l’écoute et à la détection précoce des troubles psychologiques, seront réunies à l’Université de Lomé pour écrire une nouvelle page de l’innovation sociale et de la santé mentale sur le continent. Santé mentale des femmes en Afrique : une urgence de santé publique qui ne peut plus attendreAujourd’hui, plus d’un milliard de personnes dans le monde vivent avec des troubles mentaux. L’Afrique, où 10 % de la population est concernée, fait face à une crise silencieuse, stigmatisée et dramatiquement sous-financée. Les budgets nationaux allouent en moyenne moins de 1 % à la santé mentale, laissant des millions de personnes sans accès aux soins. Quelques statistiques alarmantes : Le continent africain présente le taux de suicide le plus élevé au monde : 18 décès pour 100 000 habitants. 66 millions de femmes en Afrique souffrent d’anxiété et de dépression. L’accès aux soins reste extrêmement limité : 1 thérapeute pour 500 000 habitants, contre les recommandations de l’OMS – Organisation mondiale de la santé. Au Togo, seuls 7 psychiatres sont disponibles pour 8 millions de personnes. Moins de 5 % de la recherche mondiale est consacrée à la santé mentale. Moins de 20 % de la population africaine peut accéder à des services adaptés, freinée par des obstacles financiers, culturels et logistiques. « Heal by Hair » : une innovation sociale dans les salons de coiffure Lancé en avril 2022, Heal by Hair est né d’une idée audacieuse : former les coiffeuses à devenir des ambassadrices de la santé mentale, capables d’écouter et d’orienter leurs clientes vers des soins appropriés.Les premiers résultats sont encourageants : 4 sessions dans 3 villes africaines (Lomé, Abidjan, Douala) de 3 pays différents (Togo, Côte d’Ivoire, Cameroun) ; 2 225 coiffeuses candidates, dont 411 formées, et 152 certifiées en tant qu’ambassadrices de la santé mentale ;un potentiel de plus de 100 000 femmes ayant bénéficié de ce soutien, en termes d’impact ; des partenariats solides noués, avec 27 organisations et structures, dont les ministères de la Santé du Togo et de la Côte d’Ivoire. Une enquête non représentative menée par la Bluemind Foundation en 2021 auprès de 714 femmes dans six pays africains a montré que 67 % des femmes interrogées se confient à leurs coiffeuses, et 86 % pensent que d’autres femmes le font. Dans une autre enquête pilote menée auprès de 786 clientes des coiffeuses dans trois communes d’Abidjan, sept femmes sur dix déclarent se confier au moins parfois à leurs coiffeuses. Les coiffeuses voient en moyenne cinq à sept femmes par jour et passent beaucoup de temps avec leur clientèle, qui partage souvent des histoires de vie personnelle et dans certains cas, elles considèrent le salon comme un refuge. Lieu de détente, de confidence et de sociabilité très important, le salon de coiffure devient ainsi un espace propice à l’identification des premiers signes de détresse psychologique. Préparation d’un passage à grande échelle de Heal by Hair, avec le soutien renforcé du FID Le Fonds d’innovation pour le développement (FID), présidé par la prix Nobel 2019 Esther Duflo, a appuyé une expérimentation pilote du programme et appuie aujourd’hui son évaluation d’impact à plus grande échelle au Togo de 2025 à 2027, dans le cadre d’un financement de Stade 2, avec pour objectif de former 400 nouvelles coiffeuses et d’atteindre un nombre estimé de 472 235 femmes togolaises et africaines. En collaboration avec Innovations for Poverty Action (IPA), le programme fera l’objet d’une évaluation d’impact rigoureuse, conduite sous la forme d’un essai contrôlé randomisé. Aux côtés de chercheurs locaux et menée par les investigateurs principaux Prof. Björn Nilsson (DIAL – Université Paris Saclay) et Prof. Adrien Bouguen (Santa Clara University), cette étude suivra un échantillon représentatif de 4 800 femmes dans le Grand Lomé. Chaque donnée collectée permettra de mesurer concrètement comment Heal by Hair transforme le quotidien des femmes, améliore leur santé mentale et leur bien-être, et jette les bases d’un modèle réplicable et scalable à travers l’Afrique. Ancrée dans le terrain et soutenue par des partenariats stratégiques avec le ministère de la Santé, de l’Hygiène publique, de la Couverture sanitaire universelle et des Assurances du Togo et l’Université de Lomé, cette démarche garantit une mise en œuvre adaptée au contexte local, un suivi robuste et la pérennité des impacts. À l’origine du programme novateur Heal by Hair, la Bluemind Foundation intègre la santé mentale dans le quotidien des femmes africaines en transformant des espaces ordinaires en lieux de soutien psychologique. Pionnière de la santé mentale en Afrique, la fondation réinvente les salons de coiffure pour en faire des espaces de confiance, où le bien-être mental des clientes est pris en compte. Salué par des médias internationaux tels que The New York Times, Vogue, et Le Monde, ce programme vise à améliorer le bien-être mental des femmes africaines, une cliente à la fois, et à créer un réseau d’ambassadrices de la santé mentale dans les communautés locales. Perspectives : vers un impact continental Après le succès du projet pilote, la Bluemind Foundation vise à étendre « Heal by Hair » à l’échelle continentale et prévoit d’impacter plus d’un million de femmes au Togo, en Côte d’Ivoire, et au Cameroun d’ici cinq ans. Des discussions pour étendre le modèle au Sénégal, au Bénin, au Nigeria, au Malawi et au Zimbabwé sont en cours. « À travers ce financement de stade 2, le FID soutient la démarche d’évaluation d’impact dans laquelle s’engage Heal by Hair. C’est une démarche ambitieuse pour une jeune organisation de s’associer à une équipe de recherche pour mesurer rigoureusement les effets de son programme. C’est aussi un moyen de faire progresser les connaissances sur les enjeux de santé mentale des femmes en Afrique. », déclare Juliette Seban – directrice exécutive du FID. « Nous remercions le FID pour son soutien majeur, reconnaissant la santé mentale comme levier de développement et distinguant son importance pour le progrès social et économique. Ce partenariat renforce notre mission
« Souveraineté sanitaire : Un impératif pour l’Afrique » en débat au Forum Galien 2025

La capitale sénégalaise, Dakar, sera le théâtre de la huitième édition du « Forum Galien Afrique », qui se tiendra du 28 au 31 octobre 2025 sur le thème crucial de la « Souveraineté sanitaire : Un impératif pour l’Afrique ». Cette information a été officialisée par la présidente, la Professeure Awa Marie Coll Seck, lors d’un webinaire tenu mercredi, organisé par le Réseau des Médias africains pour la promotion de la Santé et de l’Environnement (REMAPSEN). La huitième édition du Forum Galien Afrique s’annonce comme un rassemblement de haut niveau. Selon la présidente de l’événement, la Professeure Awa Marie Coll Seck, de nombreuses sommités du monde scientifique, ainsi que des personnalités et structures régionales, prendront part à ce sommet africain très attendu. Elle a insisté sur la nécessité d’impliquer « tous les acteurs » dans la réflexion sur la souveraineté sanitaire. Le forum accueillera ainsi des ministres, des dirigeants d’associations de la société civile impliquées dans la santé, et d’importants financiers (internationaux et locaux). La présence de grandes organisations, telles que les fondations Rockefeller et Gates, est également confirmée. Ces partenaires viendront soutenir les experts, les décideurs et les acteurs communautaires africains qui se pencheront sur cette problématique cruciale. Ces annonces ont été faites lors d’une rencontre virtuelle avec plus de 80 professionnels des médias, membres du REMAPSEN. « Souveraineté sanitaire : Un impératif pour l’Afrique » : le cri de ralliement du Forum GalienLa Professeure Awa Marie Coll Seck a qualifié la souveraineté sanitaire de « vrai défi » et de « combat de longue haleine » que l’Afrique se doit de relever.La présidente du Forum Galien a justifié l’importance du thème en expliquant que la rencontre rassemblera tous les horizons – ONG, société civile, secteur privé, ministres et partenaires – afin d’assurer des réformes concrètes. Elle s’est montrée confiante quant à la contribution de chaque partenaire.Cependant, l’ancienne ministre sénégalaise a lancé un appel vigoureux aux médias, soulignant qu’il est crucial de « faire pression » sur les dirigeants. « Les médias, vous en tant que journalistes, vous avez un rôle clé à jouer en mettant ces sujets au premier plan, en les inscrivant comme des priorités auprès de nos dirigeants », a-t-elle insisté. Malgré les retards accumulés sur le continent, la spécialiste a exhorté à la persévérance : « La lenteur de l’action politique dans certains pays africains, ne doivent pas nous empêcher de poser les bonnes questions. Si nous ne les posons pas, elles ne seront jamais résolues. » Quid sur le Prix Galien Afrique Le Prix Galien Afrique, qui en est à sa cinquième édition, sera l’un des moments clés du 8e Forum Galien Afrique. Ce prix vise à récompenser les initiatives africaines les plus innovantes dans le domaine de la santé et de la recherche. Selon le Co-président du jury, le Docteur John Nkengasong, le Prix Galien distingue spécifiquement les produits, services ou technologies récemment mis sur le marché africain. Il a souligné que la souveraineté sanitaire est indissociable de la recherche, de l’innovation et de l’entrepreneuriat sur le continent, dans un contexte de forte évolution de la santé mondiale. Les lauréats seront choisis sur la base de deux critères : leur innovation scientifique et leur impact concret sur les populations africaines. Quatre catégories seront récompensées : meilleur produit pharmaceutique, meilleur produit de tradi-thérapie, meilleure technologie médicale/solution digitale, et meilleur produit biotechnologique. Wilfrid Lawilla D.
Les femmes au cœur du développement : comment la microfinance dynamise les entreprises dirigées par des femmes en Afrique

Partout en Afrique, les entreprises dirigées par des femmes sont confrontées à des obstacles bien connus qui entravent leur croissance et leur accès au financement. Beaucoup de femmes ne peuvent pas utiliser des terrains, des biens immobiliers ou des actifs majeurs comme garantie, car elles n’en sont pas propriétaires. Elles ont donc souvent recours à des services financiers informels, tels que les groupes d’épargne. La méfiance envers les banques, qui découle parfois d’expériences passées ou d’une connaissance limitée du monde financier, restreint encore davantage leur accès au crédit. Les responsabilités domestiques, notamment la garde des enfants et la prise en charge des personnes dépendantes, font que beaucoup de femmes ont moins de ressources à épargner ou à réinvestir dans leur entreprise. De plus, les normes liées au genre et les restrictions en matière de prise de décision et de mobilité créent des obstacles supplémentaires. En Afrique du Nord et de l’Ouest, notamment en Tunisie, au Ghana et en Côte d’Ivoire, Advans explore des moyens de combler ces lacunes. En concevant des produits sur mesure, en nouant des partenariats avec des acteurs locaux de confiance et en menant des évaluations rigoureuses, Advans apprend à rendre les services financiers accessibles et faciles à utiliser pour les femmes. Les entrepreneurs ont besoin de financement pour se développer, et la plupart de ces entreprises sont viables mais restent vulnérables en l’absence de systèmes financiers structurés. Les risques sont encore plus importants dans le secteur agricole, où les chocs climatiques et la volatilité des marchés ont un impact disproportionné sur les femmes. Selon le CGAP, les agricultrices ont moins accès au financement, aux outils d’adaptation et aux ressources de gestion des risques que les agriculteurs.[1] En Tunisie, Advans Tunisie a lancé El Beya, un prêt spécialement conçu pour les femmes. D’un montant compris entre 1 000 et 10 000 dinars tunisiens (environ 300 à 3 000 euros), ces prêts sont assortis de frais moins élevés et d’exigences moins strictes en matière de garanties. Après deux cycles de prêt, les femmes peuvent emprunter des montants plus importants sans fournir de garantie. Une étude de suivi réalisée en juin 2025 a révélé que 82 % des clientes avaient augmenté leurs revenus, 39 % avaient dépensé davantage pour l’éducation et 13 % avaient créé des emplois.[2] Au Ghana, le programme AdvansHer propose aux femmes entrepreneurs un accompagnement personnalisé dans la promotion sur les réseaux sociaux, la comptabilité et la structuration d’entreprise. Plus de 100 PME dirigées par des femmes y ont participé depuis son lancement, avec le soutien de la Banque de Développement du Ghana. L’institution a également lancé un programme d’épargne pour les frais de scolarité appelé EduSave, spécialement destiné aux femmes. Vicentia Ananepia[3], dirigeante d’une entreprise d’accessoires de mode au Ghana, se souvient du moment où elle a failli perdre une cargaison. À ses débuts, son mari l’a aidée à financer le lancement de son entreprise. Mais lorsque de sérieux obstacles se sont présentés, elle a dû trouver elle-même une solution. « Un jour, mes marchandises sont arrivées de Chine, mais je n’avais pas les moyens d’aller les récupérer », explique-t-elle dans son témoignage. « Je me suis donc tournée vers Advans. Ils m’ont prêté de l’argent pour payer mes factures et j’ai pu mettre les marchandises en vente. » Ce prêt a été le coup de pouce qui l’a aidée à développer son activité. Aujourd’hui, elle possède trois boutiques. « En tant que femme, je suis fière de moi, car il n’est pas facile pour une femme de faire du négoce. » Les modèles d’Advans ne reposent pas que sur l’octroi de prêts ; ils visent à faciliter les activités commerciales, en fournissant des services financiers variés et adaptés aux besoins des clients. La Côte d’Ivoire en est un autre exemple : Advans y a conçu des produits d’épargne et de crédit destinés aux femmes rurales par l’intermédiaire d’associations villageoises d’épargne et de crédit (AVEC) et de coopératives, en particulier dans les régions productrices de cacao.[4] Au-delà de la Côte d’Ivoire, les résultats obtenus à travers le groupe Advans sont palpables : le réseau dessert désormais plus de 240 000 femmes, dont plus de 26 000 ont contracté un emprunt. Les femmes représentent 35 % de l’ensemble des épargnants du réseau.[5] Le Kenya illustre ce que la finance inclusive peut accomplir à grande échelle. En 2024, l’adoption généralisée du ‘mobile money’ avait réduit l’écart entre les genres en matière d’accès aux services financiers à seulement 1,6 %, contre des écarts persistants de 12 points de pourcentage en Afrique subsaharienne et de 15 points au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, selon le Global Findex 2025 de la Banque Mondiale.[6] Le constat est clair : l’inclusion financière des femmes ne consiste pas à simplifier les produits existants, mais à les repenser en profondeur. Les outils financiers doivent refléter la manière dont les femmes vivent, gagnent leur vie et planifient leur avenir. Une note du FMI sur l’égalité des genres publiée en 2023 souligne que lorsque les femmes ont accès à des services financiers adaptés, les retombées positives se répercutent sur l’ensemble de la société, favorisant le bien-être familial, renforçant la résilience économique et développant le capital humain.[7] Que ce soit à travers El Beya en Tunisie, AdvansHer au Ghana ou les services d’épargne et de crédit liés aux AVEC en Côte d’Ivoire, nous constatons chez Advans que les femmes adoptent plus rapidement les services et obtiennent de meilleurs résultats lorsque les produits sont conçus pour répondre à leurs réalités. Il ne s’agit pas de réduire les obstacles, mais d’adapter les solutions aux réalités des femmes. Par Wilfried Sam [1]CGAP – women in rural/ag livelihoods overview: Financial Solutions for Women in Rural & Agricultural Livelihoods. [2]Advans Tunisia – El Beya results (June 2025): Advans services help empower Tunisian female entrepreneurs. [3]To safeguard her anonymity, the client’s surname has been modified [4]Advans Côte d’Ivoire – cooperative/VSLA model: Cooperatives: A Key Driver for MFIs to Improve the Livelihoods of Cocoa-Producing Communities. [5]Advans International – female client footprint (public
Revue de presse: L’Afrique dans la presse internationale

Mercredi 17/09. Le Monde Afrique : Le premier ministre, Ousmane Sonko, a annoncé le lancement de « titres patriotes et citoyens » auprès des Sénégalais établis à l’étranger. Objectif : financer une partie de son « plan de redressement » destiné à rééquilibrer les comptes du pays. RT en français : La Cour d’assises de Paris a ouvert le 16 septembre le procès en appel de Sosthène Munyemana, ancien gynécologue rwandais condamné en 2023 à 24 ans de réclusion pour génocide et crimes contre l’humanité. Jeune Afrique : Accusé par Bangui d’avoir été l’un des relais de la communication de l’ex-chef rebelle Armel Sayo, le cyberactiviste centrafricain, interpellé à Cotonou, fait l’objet d’une demande d’extradition. Pour l’heure, sans succès. TV5monde : Cela fait cinq ans que les Guinéens n’ont pas voté. Dimanche 21 septembre, c’est donc le grand retour aux urnes pour les 6.7 millions d’électeurs du pays. L’objet du scrutin: un référendum. Pour ou contre le projet de Constitution proposé par les autorités militaires au pouvoir? Sputnik : Les cryptos peuvent se superposer aux multiples monnaies nationales, a déclaré à Sputnik Afrique Yamb Ntimba, économiste, écrivain et philosophe camerounais, commentant la croissance de plus de 50% des transactions en cryptomonnaies en Afrique subsaharienne au cours de l’année financière 2024. Mardi 16/09. La Libre Afrique : Avec la chute annoncée dans les tout prochains jours de Vital Kamerhe et d’une partie de son bureau (le premier vice-président, Jean-Claude Tshilumbayi, et le 2e vice-président, Christophe Mboso, sont épargnés par la motion), c’est la musique du changement de la Constitution pour permettre à Félix Tshisekedi de se maintenir au pouvoir après 2028 qui revient dans toutes les têtes. France 24 : En Côte d’Ivoire, où la moitié de la population a moins de 30 ans, le chômage des jeunes reste deux fois supérieur à la moyenne nationale. Malgré les efforts du gouvernement, l’accès à un emploi décent demeure un défi pour les jeunes ivoiriens. RT en français : En RDC, les rebelles de l’AFC/M23 sont accusés de traitements inhumains, d’actes de torture et d’humiliation qui auraient été commis à l’encontre de militaires congolais, selon le témoignage d’un sergent évadé de captivité. Le Monde Afrique : Cinq personnes rapatriées au Nigeria et en Gambie, où elles sont parfois menacées de persécutions ou de torture, accusent Washington d’avoir téléguidé leur retour illégal via Accra. Jeune Afrique : Les ministres de la Justice des trois pays de l’Alliance des États du Sahel (AES) se sont réunis ce mardi pour discuter des modalités d’un retrait coordonné de la Cour pénale internationale, qu’ils souhaitent remplacer par une Cour pénale sahélienne. Lundi 15/09. France 24 : Au Cameroun, Issa Tchiroma Bakary, ancien ministre de Paul Biya a été désigné par le Front du changement 2025, comme candidat « consensuel » d’une partie de l’opposition. Une désignation qui est pourtant loin de faire l’unanimité. RT en français : La Foire commerciale intra-africaine (IATF 2025), dans sa 4ᵉ édition organisée à Alger du 4 au 10 septembre, « a été un plein succès, reconnu par toutes les institutions continentales associées à son organisation, et salué par l’ensemble des participants : exposants, opérateurs économiques et visiteurs », selon le chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf. Adrien Thyg
Opinion – L’Afrique doit tirer parti du Fonds pour la réponse aux pertes et dommages afin de renforcer la résilience de ses villes

TRIBUNE. La question du changement climatique et de ses répercussions, en particulier sur les villes africaines, est un sujet crucial qui nécessite une attention urgente. Chaque jour, l’Afrique subit les conséquences d’un phénomène dont elle n’est pas responsable. Alors que 7 des 10 pays les plus vulnérables au changement climatique se trouvent en Afrique, ce continent n’émet qu’environ 4 % des gaz à effet de serre, et sa contribution historique est encore plus faible, selon le rapport 2022 de l’Organisation météorologique mondiale sur l’état du climat mondial. Les vagues de chaleur, les fortes pluies, les inondations, les cyclones tropicaux et les sécheresses prolongées, qui sont quelques-uns des effets du changement climatique, ont des conséquences dévastatrices sur les communautés et les économies, et de plus en plus de personnes sont menacées à travers le continent. Les villes africaines en pleine expansion sont les plus touchées par cette vulnérabilité et ces conséquences. Selon le rapport de l’OCDE, l’Afrique est l’un des continents les moins urbanisés au monde, mais elle abrite la région qui connaît l’urbanisation la plus rapide : l’Afrique subsaharienne (ASS). La région compte une population urbaine de 500 millions de personnes, soit environ 40 % de la population du continent, et un taux de croissance urbaine deux fois supérieur à la moyenne mondiale, avec 4,1 % par an, contre 2,1 % en moyenne mondiale. D’ici 2050, on estime que plus de 60 % des Africains vivront dans des zones urbaines. Cette croissance urbaine accélérée accentue encore les défis existants, tels que l’insuffisance des infrastructures, l’accès limité aux services de base, le chômage et la pénurie de logements. Selon les rapports 2024 de l’African Cities Research Consortium et de Brookings, environ 56 % de la population urbaine africaine vit dans des quartiers informels, où s’ajoutent à cela l’insécurité foncière et l’accès limité aux services d’infrastructure essentiels tels que l’assainissement, l’eau et l’énergie. Une crise climatique Il est largement reconnu que le changement climatique aura une incidence sur la trajectoire de développement socio-économique de l’Afrique, menaçant la réalisation des objectifs de développement durable à l’horizon 2030 et des objectifs de l’Agenda 2063 de l’Union africaine. Selon les propres termes du secrétaire général des Nations unies, António Guterres, « l’Afrique est en première ligne de la crise climatique. Il est temps d’agir. Nous devons investir dans des solutions durables pour protéger nos populations et notre planète ». Mais tout n’est pas perdu. L’une des récentes évolutions mondiales en matière de politique climatique a été la création du Fonds pour la réponse aux pertes et dommages (FRLD), qui vise à fournir un soutien financier aux pays vulnérables touchés par les catastrophes climatiques. Créé lors des négociations de la COP27, ce fonds recèle un potentiel considérable pour les pays africains, en particulier dans le contexte du développement urbain et des défis auxquels sont confrontées les villes en pleine expansion à travers le continent. Il pourrait constituer un outil puissant pour faire face à la fois aux conséquences immédiates des catastrophes climatiques et aux besoins à long terme en matière de développement urbain durable en Afrique, grâce au principe « reconstruire en mieux ». Tout d’abord, le Fonds pourrait être affecté à des efforts de secours et de reconstruction immédiats, tels que la reconstruction de logements, l’amélioration des systèmes de drainage pour atténuer les inondations et la garantie d’un accès à l’eau potable et à l’assainissement. Par exemple, le financement pourrait soutenir la mise en place d’infrastructures capables de résister aux catastrophes naturelles, telles que des logements résilients et abordables et d’autres infrastructures urbaines résilientes au climat. Il est essentiel, dans toutes les activités que le Fonds soutiendra, de garantir la résilience au climat et de remédier aux principales pénuries d’infrastructures qui exacerbent la vulnérabilité. De tels projets permettraient de créer des villes plus durables, mieux équipées pour faire face aux effets de plus en plus marqués du changement climatique, tout en offrant des opportunités économiques grâce à la création d’emplois. Deuxièmement, le Fonds pourrait être utilisé pour autonomiser les communautés locales, en particulier les populations marginalisées des bidonvilles urbains et des quartiers informels, qui sont souvent les plus durement touchées par les catastrophes climatiques. Il est essentiel d’aider ces acteurs à s’adapter et à se développer pour garantir une résilience durable. De même, l’économie informelle, qui représente une part importante de l’économie urbaine africaine, ne doit pas être laissée pour compte. Enfin, le Fonds pourrait être utilisé pour soutenir des initiatives de renforcement des capacités telles que la formation des dirigeants locaux, le renforcement des systèmes de gestion des catastrophes et la création de partenariats climatiques significatifs. Réinventer les villes africaines Cela dit, le Fonds pour la réponse aux pertes et dommages a le potentiel de jouer un rôle transformateur dans le développement urbain des villes africaines, en particulier dans l’atténuation et l’adaptation aux effets du changement climatique. La concrétisation de ce potentiel dépendra de la configuration du Fonds et des critères utilisés pour évaluer les projets, ainsi que de leur adéquation avec les réalités africaines en termes de disponibilité des données et des capacités. Elle dépendra également d’une planification minutieuse et d’une collaboration efficace afin de garantir que le Fonds profite à ceux qui en ont le plus besoin. Il s’agit là d’une occasion unique non seulement de lutter contre les conséquences du changement climatique, mais aussi de repenser les villes africaines comme des modèles de durabilité et d’inclusivité pour l’avenir. Par le Dr Muhammad Gambo Responsable des politiques, de la recherche et des partenariats à la Banque de développement Shelter Afrique.
Coopération : Le Kazakhstan fait de la RDC son partenaire « important et fiable » en Afrique

La première visite d’Etat du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo au Kazakhstan a été marquée par une grandiose cérémonie organisée ce mercredi au palais présidentiel d’Akorda au cœur de la ville d’Astana. À son arrivée, le Chef de l’Etat congolais a été accueilli sur le parvis du palace par son homologue Kazakh Kassym- jomart Tokayev. Après la présentation des délégations respectives et la parade d’honneur , les deux chefs d’Etat ont eu deux importantes séances bilatérales , en groupe restreint puis en délégation élargie , qui leur ont permis de définir les domaines prioritaires de leur coopération. Il s’agit des domaines des ressources naturelles et les chaînes de valeurs industrielles; l’agriculture; les infrastructures; le transport et logistique; l’énergie ; le climat ainsi que l’éducation. Dans son allocution de circonstance, le Président Tokayev a indiqué que la RDC est « le partenaire important et fiable » de son pays en Afrique. « Le Kazakhstan souhaite renforcer sa coopération avec la RDC dans divers domaines; et il existe toutes les possibilités d’approfondir la coopération dans ces domaines », a dit le président Kazakh. « Nous partageons des intentions politique de haut niveau , nous disposons d’un vaste potentiel commercial et économique et avons des objectifs et des buts culturels et humanitaires similaires » a dit le président kazakh avant d’ajouter que « les résultats des négociations d’aujourd’hui en sont la preuve et nous avons convenu de porter les relations bilatérales à un nouveau niveau dans un esprit de soutien et de compréhension mutuelle » « Nous avons conclu des accords importants qui servent les intérêts des deux pays », a conclu le président Tokayev. De son côté , le président Tshisekedi a fait part de sa satisfaction à l’issue des pourparlers avec la partie Kazakhe. Il a promis de s’engager pour la matérialisation de ses engagements. Deux mémorandums d’entente ( MOU) ont été signés entre les officiels des deux pays .Le premier mémorandum d’entente signé par la ministre d’Etat aux affaires étrangères Therese Kayikwamba et son homologue Murat Nuetileu porte sur les consultations politiques et diplomatiques . Le deuxième accord de coopération dans les domaines des mines et de géologie a été signé par le ministre des mines Louis Watum et Yersayin Nagaspaev , ministre de l’industrie et de la construction de la République du Kazakhstan. En marge de cette visite d’Etat, la président du conseil d’administration de la Gecamines , Guy Robert Lukama Nkunzi a signé un accord de collaboration avec l’entreprise Kazakhe Eurasian Ressources Group ( ERG) installée à Kolwezi en RDC. Par ailleurs , en présence des officiels congolais et kazakhs, le président Kassym- jomart Tokayev a décoré son hôte de marque Félix Tshisekedi de « la plus haute distinction civique » réservée aux chefs d’Etat étrangers .
7 SEPTEMBRE 869 : DE LA CASTRATION DES NOIRS A LEUR INSURRECTION…

HISTOIRE. Nous africains, avons pris l’habitude de beaucoup ergoter sur la traite des esclaves noirs pratiquée par les nations occidentales via le commerce triangulaire de l’Océan Atlantique. Beaucoup parmi nous ignorent qu’il en existe une autre, encore plus cruelle, notamment la traite des noirs africains par les nations arabo-musulmanes. La technique de guerre usée par ces dernières était les razzias. Après avoir encerclé un village en pleine nuit, les guetteurs éliminés, un meneur poussait un cri afin que ses complices allument leurs torches. Les villageois surpris dans leur sommeil étaient mis hors d’état de se défendre, les hommes et les femmes âgées massacrées ; le reste était garrotté en vue du futur et long trajet. Ceux qui avaient réussi à s’enfuir étaient pourchassés par les molosses dressés à la chasse à l’homme. Il arrivait que des fugitifs se réfugient dans la savane, à laquelle les trafiquants mettaient le feu pour les débusquer. Les capturés furent acheminés à travers le désert dans des conditions impitoyables. Les adultes mâles « accouplés » à l’aide d’une fourche de bois et retenus par un collier de fer (qui à la longue creusait les chairs) au cours de leur interminable et dur trajet. 20% des captifs périssaient durant le voyage. Et une fois arrivés à destination du pays des bourreaux, il s’opérait une sélection drastique. Les femmes belles étaient des « bonnes à tout faire » placées dans le harem pour le plaisir sexuel des arabes et les moins belles allaient paitre les troupeaux. Quant aux hommes, ils étaient destinés aux travaux domestiques et agricoles, ou incorporés dans le corps d’armée ou encore affectés à la surveillance des harems. Le même sort les attendait tous : la castration pour éviter qu’ils se reproduisent. Ils se faisaient entièrement coupés le scrotum ainsi que leurs pénis afin d’éviter qu’ils ne se reproduisent. La castration se pratiquait sans anesthésie, plus de 60% ne survivaient pas à la procédure et étaient laissés pour mort, se vidant de leurs sang. Afin de stopper l’hémorragie, les arabes utilisaient du charbon ardent posé directement sur la plaie nue. Ils devenaient complètement des eunuques. Selon les historiens, la traite des noirs par les arabes a duré quasi un millénaire, de 650 après J.-C. jusqu’à ce jour. Jusqu’au siècle dernier, bien avant la crise libyenne, on comptabilisait plus de 20 millions de noirs ayant péri suite à ces traitements inhumains. Ils ont disparu sans laisser de traces suite aux castrations dont ils étaient victimes. Ce fut un véritable holocauste, une extermination programmée d’une race ! L’ouvrage très documenté de Tidiane N’diaye (Le génocide voilé : enquête historique) est très instructif sur les crimes innommables des nations arabo-musulmanes sur les noirs africains. Ces africains noirs captifs furent dispersés dans différentes nations arabo-musulmanes comme en Mésopotamie, l’actuel Irak ou en Perse l’Iran. Ils étaient appelés Zendjs et ce sont eux qui étaient affectés à la construction des villes comme Bagdad et Basra. Conformément à ce que rapporte l’historien Ibn-Khaldum, l’idéologie commune aux nations arabo-musulmanes était la suivante : « les seuls peuples à accepter l’esclavage sont les nègres, en raison d’un degré inférieur d’humanité, leur place étant plus proche du stade animal ». Pour cette raison, les Zendjs étaient considérés comme des sous-hommes par les arabes. C’était pour eux un moyen de leur nier toute dignité humaine pour mieux les asservir et les soumettre au sevrage. Ce que l’histoire nous cache, c’est que ces captifs africains avaient réussi à organiser trois grandes révoltes contre leurs bourreaux. Dans ce pays les Noirs étaient affectés aux tâches les plus rebutantes. Parqués sur leur lieu de travail dans des conditions misérables, ils percevaient pour toute nourriture quelques poignées de semoule et des dattes. Les Africains laisseront éclater leur haine avec l’objectif de détruire Bagdad, la cité symbole de tous les vices. Armés de simples gourdins ou de houes et formés en petites bandes, ils se soulevèrent dès l’an 689. D’après l’étude fouillée d’Abdoulaye Mbaye, cette première insurrection se produisit au cours du gouvernement de Khâlid ibn `Abdallah, successeur de Mus`ab ibn al-Zubayr. Les révoltés qui s’étaient organisés avaient réussi par la suite, à se procurer des armes. Ils se fortifièrent dans des camps installés à des endroits inaccessibles. Et à partir de ces différents points, ils lançaient des raids. Un grand nombre d’embuscades et de batailles tournèrent à leur avantage. Ils réussirent par la suite à s’emparer de principales villes du bas Irak et du Khûzistân comme al-Ubulla, Abbâdân, Basra, Wâsit, Djubba, Ahwâz etc. Les troupes abbassides allaient toutefois réussir à réoccuper sans mal, toutes ces villes que les Zendjs avaient prises, pillées puis abandonnées. Les Zendjs seront finalement vaincus, les prisonniers remis en esclavage ou décapités et leurs cadavres pendus au gibet. Ceci ne les dissuadera pas de fomenter une seconde révolte mieux organisée. Cette insurrection eut lieu cinq ans plus tard, en 694. Elle semble avoir été plus importante que la première, et surtout mieux préparée. Cette fois, les Zendjs furent rejoints par d’autres Noirs déserteurs des armées du calife, des esclaves gardiens de troupeaux venus du Sud en Inde et aussi d’autres originaires de l’intérieur du continent africain. Les insurgés infligèrent dans un premier temps, une lourde défaite à l’armée du calife venue de Bagdad, avant d’être battus. Les armées arabes furent néanmoins obligées de s’y prendre à deux fois pour les écraser. Quant à la troisième révolte des Zendjs, elle est la plus connue et la plus importante. Elle secoua très fortement le bas Irak et le Khûzistân, causant des dégâts matériels énormes et des centaines de milliers de morts voire plus de deux millions selon certaines sources. C’est le 7 septembre 869, que sous les ordres d’un chef noir charismatique, Ali Ben Mohammed surnommé « Sâhib al-Zandj » qui veut dire le « Maître des Zendjs » que les Africains se soulevèrent. L’homme était d’origines assez obscures ¬ mais avait visiblement pu approcher les classes dirigeantes de son époque. Il était également un poète talentueux, instruit, versé dans les sciences occultes et socialement
Tchitemb’u Li Tchikayi Tchiloang’u à Macron: « Les Français ne veulent pas mourir pour vos illusions de grandeur »

FRANCE. Dans une lettre adressée au président de la République française, que nous reproduisons ci-dessous, Tchitemb’u Li Tchikayi Tchiloang’u, citoyen français et fils de l’immigration africaine, appelle Emmanuel Macron à ne pas s’accrocher à un pouvoir qui lui échappe et qui, selon lui, « détruit peu à peu » la France. « Lettre d’un citoyen français, fils de l’immigration africaine, au président Emmanuel Macron Monsieur Macron, Quand vous êtes apparu en 2017, je vous ai cru. Comme tant d’autres, j’ai porté l’espoir que vous incarniez le renouveau. J’ai collé vos affiches. J’ai assisté à vos meetings. J’ai défendu votre nom auprès de mes proches. Je croyais sincèrement que vous alliez changer la France, tourner la page des vieilles pratiques, ouvrir un horizon. Vous étiez jeune, ambitieux, vous vous présentiez comme le visage du futur. Mais quelle désillusion ! La France est aujourd’hui plus endettée que jamais, écrasée par plus de 1200 milliards ajoutés sous votre règne. Vous avez promis de libérer, vous avez enchaîné. Vous avez promis de réformer, vous avez ruiné. Vous avez promis d’écouter, vous avez méprisé. Vous avez érigé votre présidence en trône jupitérien, loin des souffrances réelles du peuple. Et voilà maintenant que vous jouez avec le feu de la guerre, alors que le peuple crie son refus. Les Français ne veulent pas mourir pour vos illusions de grandeur ni pour vos calculs diplomatiques. Nous voulons la paix, pas la marche forcée vers le chaos. Quant à l’Afrique, permettez-moi de vous le dire avec colère et amertume : votre politique y a été un désastre. Vous prétendiez rompre avec les logiques coloniales, et vous n’avez fait que reproduire les vieilles méthodes paternalistes, aggravant le rejet de la France sur un continent qui ne demandait qu’un partenariat juste et respectueux. Vous avez perdu l’Afrique comme vous avez perdu la France. Monsieur Macron, ayez au moins un geste de lucidité : partez. Démissionnez. Ne vous accrochez pas à ce pouvoir qui vous échappe, et qui détruit peu à peu le pays. La France mérite mieux que cette fuite en avant. Vous aviez notre confiance. Vous l’avez trahie. L’Histoire, elle, ne vous pardonnera pas. Tchitemb’u Li Tchikayi Tchiloang’u Un citoyen français, Fils de l’immigration africaine, Déçu mais pas résigné ».