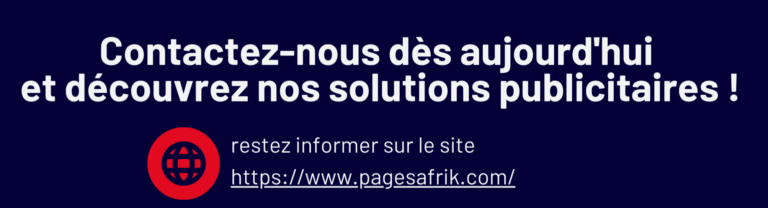Ces cinq pays africains ont les devises les plus fortes
Sur fond de dédollarisation, les monnaies nationales montent en puissance sur le continent africain. Certains pays peuvent se targuer d’avoir des devises solides face au billet vert, à en croire Google Finance et Forbes Currency Converter. En ces temps de turbulences économiques, certaines économies d’Afrique peuvent compter sur une monnaie forte pour préserver le pouvoir d’achat des populations et faciliter les importations. Voici les monnaies les plus fortes du continent ce 12 février, selon les données de Google Finance et Forbes Currency Converter. – Tunisie (3,13 dinars contre un dollar) – Libye (4,83 dinars/dollar) – Maroc (10 dirhams/dollar) – Ghana (12,39 cédi/dollar) – Seychelles (13,48 roupies/dollar) Les monnaies nationales ont fait un retour remarqué dans le commerce international, alors que le règne du dollar commence à s’effriter. L’émergence d’un monde multipolaire pousse les pays à commercer de plus en plus dans leur devise respective. Même le marché des hydrocarbures, longtemps chasse gardée du pétrodollar, commence à s’émanciper du billet vert. En mars 2023, la Chine avait notamment acheté pour 65.000 tonnes de gaz naturel liquéfié émirati, en réglant en yuans, pratique exceptionnelle dans le secteur. Sur le continent africain, certains acteurs militent aussi pour l’abandon du dollar dans le commerce entre voisins. Le Président kenyan William Ruto, l’une des figures de proue de ce combat, s’était notamment plaint que les commerçants kenyans doivent transiter par le billet vert et payer d’important frais pour échanger avec leurs homologues djiboutiens, en juin dernier. Retrouvez cet article sur Sputniknews
Les « Profils genre pays » de la Banque africaine de développement révèlent des progrès dans la lutte contre la discrimination fondée sur le genre aux Comores, en République démocratique du Congo, au Soudan du Sud et aux Seychelles

Les rapports de la Banque africaine de développement sur les Comores, la République démocratique du Congo, le Soudan du Sud et les Seychelles montrent des progrès dans la lutte contre la discrimination fondée sur le genre — malgré des taux de progression inégaux — et fournissent de nouvelles données pour aider à élaborer des politiques visant à accélérer l’égalité entre les genres. Les « Profils genre pays » du Groupe de la Banque africaine de développement évaluent l’état de l’égalité des genres dans chaque pays et fournissent des recommandations concrètes sur les actions à mener. Préparés en collaboration avec les pays membres régionaux de la Banque, les organisations de la société civile et les partenaires au développement, dont ONU Femmes et l’Union européenne, ce sont des guides de référence pour renforcer la prise en compte de la dimension de genre dans les interventions de développement, améliorer l’égalité des genres et favoriser l’autonomisation des femmes. « Nous ne pouvons améliorer que ce que nous connaissons, et ce que nous connaissons est ce que nous mesurons. Les données que nous recueillons grâce aux Profils genre pays constituent un outil de développement essentiel pour améliorer la conception, la mise en œuvre et le suivi des politiques et des actions fondées sur des données probantes », a déclaré Basil Jones, coordinateur de programmes et de politiques genre de la Banque. Malgré les progrès réalisés, les profils montrent que la pauvreté touche les femmes de manière disproportionnée. La pandémie de Covid-19, associée à l’impact des crises mondiales, en particulier sur la sécurité alimentaire, a aggravé les inégalités de genre, en particulier la violence fondée sur le genre. Voici quelques points saillants des profils : Depuis 2020, la Banque a publié plus d’une vingtaine de « Profils genre pays ». Les dernières publications s’inscrivent dans le cadre du déploiement de la stratégie de la Banque en matière d’égalité de genres pour la période 2021-2025, intitulée « Investir dans les femmes africaines pour accélérer la croissance inclusive. » En 2023, la Banque a également publié des profils pour le Rwanda, la Zambie, la Tanzanie (Zanzibar), le Ghana et le Nigéria.
Seychelles : la Banque mondiale accompagne la réforme du système de protection sociale
La Banque mondiale a approuvé récemment un financement de 30 millions de dollars en faveur des Seychelles, afin de soutenir l’action menée par les autorités en vue de renforcer l’efficacité des dispositifs de protection sociale. « Ce financement contribuera à l’adaptation du système de protection sociale aux défis qui se posent au pays, notamment l’évolution démographique et la relance post-COVID, tout en mettant l’accent sur la lutte contre les multiples causes de la pauvreté et de l’exclusion », précise Erik von Uexkull, représentant de la Banque mondiale aux Seychelles. Le système en vigueur dans le pays est généreux et étendu, mais fragmenté : il englobe pas moins de 30 dispositifs, depuis les pensions universelles et la sécurité sociale pour les pauvres jusqu’à des programmes ciblant les orphelins et les personnes handicapées. Ce constat a amené le gouvernement des Seychelles à demander l’aide de la Banque mondiale pour améliorer l’efficacité et la qualité du système de protection sociale. « La Banque mondiale soutiendra les efforts du gouvernement pour améliorer le fonctionnement et l’efficacité des programmes existants sur la base des bonnes pratiques internationales, afin qu’un pourcentage plus élevé des dépenses sociales soit alloué aux personnes dans le besoin, explique Edmundo Murrugarra, économiste senior pour la protection sociale à la Banque mondiale et responsable du projet. Il est en effet nécessaire de renforcer le système, d’une part pour s’assurer qu’il alloue davantage de ressources aux 40 % de la population au bas de l’échelle des revenus et, d’autre part, pour le rendre plus efficace. » Le pays a consacré près de 7 % de son PIB à la protection sociale en 2020, un pourcentage supérieur aux moyennes observées en Afrique subsaharienne, dans les petits États insulaires et dans les pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure, même en tenant compte des effets de la COVID-19. « La structure actuelle du système de protection sociale a permis de réduire la pauvreté, ajoute Anita M. Schwarz, économiste principale à la Banque mondiale et coresponsable du projet. Néanmoins, elle doit être adaptée au nouveau contexte démographique, car les dépenses sociales actuelles sont très largement orientées vers la population âgée. » Ainsi, les personnes âgées représentent 9 % de la population, mais elles constituent 22 % du nombre total des bénéficiaires des programmes non contributifs et reçoivent jusqu’à 42 % de la totalité des prestations. CP
Les Seychelles deviennent le premier pays africain à commencer à utiliser le vaccin Sinopharm (CGTN)